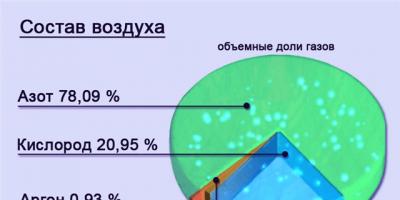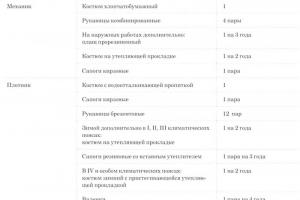Le scepticisme en philosophie est une direction distincte. Un représentant d’un courant est une personne capable de voir sous un angle différent ce que croit la grande majorité des gens. Doutes communes, critiques, analyses et conclusions sobres : tels peuvent être considérés comme les postulats des philosophes sceptiques. Lorsque le mouvement est né, nous vous dirons qui étaient ses principaux adhérents dans cet article.
Aujourd’hui, les sceptiques sont associés à des gens qui nient tout. Nous considérons les sceptiques comme des pessimistes et, avec un léger sourire, nous les appelons « Thomas incroyants ». Ils ne croient pas les sceptiques, ils pensent qu’ils ne font que râler et se donnent pour mission de nier même les choses les plus évidentes. Mais le scepticisme est une école philosophique puissante et ancienne. Il a été suivi depuis l'Antiquité, au Moyen Âge, et a connu un nouveau développement dans les temps modernes, lorsque le scepticisme a été repensé par les grands philosophes occidentaux.
Concept de scepticisme
L'étymologie du mot lui-même n'implique pas un déni constant, un doute pour le doute. Le mot vient du mot grec « scepticos » (skeptikos), qui est traduit par explorer ou considérer (il existe une version que la traduction signifie - regarder autour de vous, regarder autour de vous). Le scepticisme est apparu sur la vague lorsque la philosophie a été élevée au rang de culte et que toutes les déclarations des scientifiques de cette époque ont été perçues comme la vérité ultime. La nouvelle philosophie visait à analyser les postulats populaires et à les repenser.
Les sceptiques se sont concentrés sur le fait que la connaissance humaine est relative et qu'un philosophe n'a pas le droit de défendre ses dogmes comme étant les seuls corrects. A cette époque, la doctrine jouait un rôle énorme, luttant activement contre le dogmatisme.
Au fil du temps, des conséquences négatives sont apparues :
- pluralisme des normes sociales de la société (elles ont commencé à être remises en question et rejetées) ;
- négligence des valeurs humaines individuelles;
- faveur, bénéfice au nom du gain personnel.
En conséquence, le scepticisme s'est avéré être un concept contradictoire par nature : certains ont commencé à rechercher la vérité en profondeur, tandis que d'autres ont fait de l'ignorance totale et même d'un comportement immoral un idéal.
Histoire d'origine : le nirvana de Pyrrhon
L’enseignement de la philosophie du scepticisme trouve son origine dans l’Antiquité. L'ancêtre de la direction est considéré comme Pyrrhon de l'île du Péloponnèse, la ville d'Elis. La date d'origine peut être considérée comme la fin du IVe siècle avant JC (ou les dix premières années du IIIe). Qu'est-ce qui est devenu le précurseur de la nouvelle philosophie ? Il existe une version selon laquelle les vues du philosophe ont été influencées par les dialecticiens élidiens - Démocrite et Anaxarque. Mais il semble plus probable que les ascètes et sectaires indiens aient eu une influence sur l’esprit du philosophe : Perron partit en campagne avec Alexandre le Grand en Asie et fut profondément choqué par le mode de vie et la pensée des hindous.
Le scepticisme était appelé pyrrhonisme en Grèce. Et la première chose que demandait la philosophie était d’éviter les déclarations décisives et de ne pas tirer de conclusions définitives. Pyrrhon a appelé à s'arrêter, à regarder autour de lui, à réfléchir, puis à généraliser. Le but ultime du pyrrhonisme était d’atteindre ce qu’on appelle aujourd’hui communément le nirvana. Aussi paradoxal que cela puisse paraître.
Inspiré par les ascètes indiens, Pyrrhon a exhorté chacun à atteindre l'ataraxie en renonçant à la souffrance terrestre. Il a enseigné à s'abstenir de toute forme de jugement. L'ataraxie pour les philosophes est un renoncement complet au jugement. Cet état est le plus haut degré de félicité.
Au fil du temps, sa théorie a été révisée, leurs propres ajustements ont été apportés et interprétés à leur manière. Mais le scientifique lui-même y a cru jusqu'à ses derniers jours. Il a supporté les attaques de ses adversaires avec dignité et stoïcisme et est entré dans l'histoire de la philosophie comme un homme à l'esprit fort.
Anciens adeptes
À la mort de Pyrrhon, son étendard idéologique fut repris par son contemporain Timon. Il était poète, prosateur et est resté dans l'histoire comme l'auteur de « sills » - œuvres satiriques. Dans ses discours, il ridiculisait tous les mouvements philosophiques à l'exception du pyrrhonisme, des enseignements de Protagoras et de Démocrite. Timon a largement propagé les postulats de Pyrrhon, appelant chacun à reconsidérer ses valeurs et à atteindre le bonheur. Après la mort de l'écrivain, l'école du scepticisme s'est arrêtée dans son développement.
On raconte une blague à propos de Pyrrhon. Un jour, le navire sur lequel voyageait le scientifique a été pris dans une tempête. Les gens ont commencé à paniquer et seul le cochon du navire est resté calme, continuant à aspirer sereinement depuis l'auge. "C'est ainsi que doit se comporter un vrai philosophe", dit Pyrrhon en désignant le cochon.
Sextus Empric – médecin et disciple
Le disciple le plus célèbre de Pyrrhon est Sextus Empiricus, médecin et philosophe érudit. Il est devenu l'auteur de l'expression populaire : « Les moulins broient les dieux lentement, mais ils broient avec diligence. » Sextus Empiricus a publié le livre « Les Propositions de Pyrrhon », qui sert encore aujourd'hui de manuel pour tous ceux qui comprennent la philosophie en tant que science.
Particularités des œuvres de l'empiriste :
- relations étroites avec la médecine;
- le philosophe jugeait inacceptable de promouvoir le scepticisme dans une direction distincte, de le confondre et de le comparer avec d'autres mouvements ;
- le caractère encyclopédique de la présentation de toutes les informations : le philosophe a présenté sa pensée de manière très détaillée et n'a ignoré aucun détail.
Sextus Empiricus considérait le « phénomène » comme le principe principal du scepticisme et étudiait activement tous les phénomènes de manière empirique (c'est pourquoi il a reçu son pseudonyme). Le sujet d’étude du scientifique portait sur diverses sciences, allant de la médecine à la zoologie, en passant par la physique et même les chutes de météorites. Les travaux d'Empirist ont été très appréciés pour leur minutie. Plus tard, de nombreux philosophes ont volontiers tiré leurs arguments des travaux de Sextus. La recherche a reçu le titre honorifique de « général et sommatif de tout scepticisme ».

La renaissance du scepticisme
Il se trouve que pendant plusieurs siècles, la direction a été oubliée (au moins aucun philosophe brillant n'a été enregistré dans l'histoire à cette époque). La philosophie n'a été repensée qu'au Moyen Âge et un nouveau cycle de développement - à l'époque (les temps modernes).
Aux XVIe et XVIIe siècles, le balancier de l’histoire bascule vers l’Antiquité. Des philosophes sont apparus qui ont commencé à critiquer le dogmatisme, répandu dans presque toutes les sphères de l'activité humaine. À bien des égards, l’intérêt pour cette direction est né de la religion. Elle influençait les gens, fixait des règles et tout « pas à gauche » était sévèrement puni par les autorités ecclésiastiques. Le scepticisme médiéval a laissé inchangés les principes de Pyrrhon. Le mouvement s’appelait le nouveau pyrrhonisme et son idée principale était la libre pensée.
Les représentants les plus éminents :
- M.Montaigne
- P. Bayle
- D. Hume
- F. Sánchez
Le plus frappant était la philosophie de Michel Montaigne. D'une part, son scepticisme était le résultat d'une expérience de vie amère, d'une perte de confiance dans les gens. Mais d’un autre côté, Montaigne, comme Pyrrhon, exhortait les gens à rechercher le bonheur et les exhortait à abandonner leurs croyances égoïstes et leur orgueil. L'égoïsme est la principale motivation de toutes les décisions et actions des gens. Après l'avoir abandonné et l'orgueil, il est facile de devenir équilibré et heureux, après avoir compris le sens de la vie.

Pierre Bayle est devenu un éminent représentant du New Age. Il a « joué » sur le terrain religieux, ce qui est assez étrange pour un sceptique. Pour décrire brièvement la position de l'éclaireur, Bayle a suggéré de ne pas se fier aux paroles et aux croyances des prêtres, d'écouter son cœur et sa conscience. Il préconisait que l’individu soit gouverné par la moralité, et non par les croyances religieuses. Bayle est entré dans l'histoire comme un ardent sceptique et un combattant contre le dogme de l'Église. Bien que, par essence, il soit toujours resté une personne profondément religieuse.
Sur quoi repose la critique du scepticisme ?
Les principaux opposants idéologiques au scepticisme en philosophie sont toujours restés les stoïciens. Les sceptiques se sont opposés aux astrologues, aux éthiciens, aux rhéteurs et aux géomètres, exprimant des doutes sur la véracité de leurs croyances. « La connaissance nécessite la confiance », croyaient tous les sceptiques.
Mais si connaissance et certitude sont indissociables, comment les sceptiques eux-mêmes le savent-ils ? - les opposants s'y sont opposés. Cette contradiction logique a permis de largement critiquer le mouvement, le remettant en cause en tant qu’espèce.
C’est le scepticisme que beaucoup citent comme l’une des raisons de la propagation du christianisme à travers le monde. Les adeptes de la philosophie sceptique furent les premiers à remettre en question la véracité de la croyance aux anciens dieux, qui constituèrent un terrain fertile pour l'émergence d'une nouvelle religion plus puissante.
Le scepticisme antique a été l’un des mouvements philosophiques les plus influents pendant de très nombreux siècles – à partir du 4ème siècle. avant JC aux III-IV siècles. d'après R.H. Le fondateur du scepticisme antique est traditionnellement considéré comme Pyrrhon, né en Elis en 360.
AVANT JC. et a vécu jusqu'à 90 ans. Pyrrhon fait partie de ces philosophes qui n'ont pas écrit de traités philosophiques, comme Socrate, montrant par sa vie l'essence de sa philosophie. Tout ce que l'on sait de lui est principalement exposé dans le livre de Diogène Laertius. Nous en apprenons que Pyrrhon s'est abstenu de tout jugement, c'est-à-dire il avait des doutes sur la connaissance de l'essence des choses. Et, étant un philosophe cohérent, il s'est efforcé de suivre cet enseignement tout au long de sa vie. Comme le souligne Diogène Laertius, « conformément à cela, il a mené sa vie, sans rien éluder, sans rien éviter, étant exposé à aucun danger, qu'il s'agisse d'une charrette, d'une pente raide ou d'un chien, mais sans succomber aux sensations de quoi que ce soit. , ils l’ont sauvé des dangers les amis qui le suivaient » (D.L. IX, 62). C’est une affirmation assez étrange car, comme nous le verrons, elle contredit l’essence de la philosophie sceptique. Au début, Pyrrhon était engagé dans la peinture ; un tableau qu'il a peint d'une manière plutôt médiocre a survécu. Il vivait dans la solitude, se montrant rarement même à la maison. Les habitants d'Elis le respectèrent pour son intelligence et l'élirent grand prêtre. Ce fait nous amène encore une fois à réfléchir - il n'est pas clair comment une personne, avec un comportement si extravagant, pourrait devenir un grand prêtre. De plus, pour lui, il fut décidé d'exonérer tous les philosophes d'impôts. Diogène Laertius écrit en outre que plus d'une fois il a quitté la maison sans rien dire à personne et s'est promené avec n'importe qui. Un jour son ami Anaxarchus tomba dans un marécage, Pyrrhon passa sans lui serrer la main. Tout le monde le grondait, mais Anaxarchus le félicitait. Il vivait avec sa sœur, sage-femme, et allait au marché pour vendre des poulets et des porcelets.
Un incident célèbre est mentionné par Diogène Laertius : alors que Pyrrhon naviguait sur un navire et qu'il était pris dans une tempête avec ses compagnons, tout le monde commença à paniquer, seul Pyrrhon seul, désignant le cochon du navire, qui aspirait sereinement de son à travers, a dit que c'est exactement ainsi qu'un vrai homme devrait se comporter.
On sait peu de choses sur Timon, l'élève de Pyrrhon : seulement qu'il était poète et exprimait ses enseignements sous forme de poésie, syl. Par la suite, des idées sceptiques ont commencé à se développer au sein de l’Académie de Platon au IIe siècle. avant JC Les étudiants de Platon ont développé à leur manière les enseignements du fondateur de l'Académie. Les savants Carnéade et Arcésilas, se considérant comme de vrais platoniciens, ont commencé à développer le thème de la critique du sensationnalisme et sont arrivés à la conclusion que la vérité est inconnaissable. Les œuvres de Carnéade et d'Arcésilas n'ont pas survécu. L’ancien orateur et philosophe romain Cicéron est un partisan du scepticisme académique. Beaucoup de ses travaux nous sont parvenus, où il expose sa compréhension du scepticisme académique. Nous pouvons également nous familiariser avec le scepticisme académique dans l’œuvre de Bienheureux. "Contre les académiciens" d'Augustin, où il critique leur enseignement.
Le pyrrhonisme fut ensuite relancé au Ier siècle. avant JC par Énésidème et Agrippa puis au IIe siècle. d'après R.H. de Sextus Empiricus, systématiseur et peut-être le représentant le plus talentueux du pyrrhonisme. Sextus Empiricus a écrit deux ouvrages : « Trois livres de propositions de Pyrrhon » et « Contre les savants ». Aux III-IV siècles. des éléments de scepticisme peuvent être trouvés chez le célèbre médecin Galien.
Le scepticisme antique, comme toute la philosophie hellénistique, posait avant tout des questions éthiques, considérant la principale solution au problème de savoir comment vivre dans ce monde, comment parvenir à une vie heureuse. On pense généralement que le scepticisme est avant tout un doute sur la connaissabilité de la vérité, et c'est pourquoi ils réduisent le scepticisme à la seule théorie de la connaissance. Or, cela n’est pas du tout vrai en ce qui concerne le pyrrhonisme. Bien sûr, il existe des doutes quant à la possibilité de connaître la vérité sur le pyrrhonisme, mais celui-ci joue un rôle auxiliaire dans la résolution des problèmes éthiques.
Sextus Empiricus divise toutes les écoles philosophiques en deux groupes : dogmatiques et sceptiques. Il divise également les dogmatiques en dogmatiques et académiciens. Les dogmatiques et les académiciens croient avoir déjà tranché la question de la vérité : les dogmatiques, c'est-à-dire les adeptes d’Aristote, d’Épicure, des stoïciens, etc. prétendent avoir trouvé la vérité, et les universitaires prétendent (également de manière dogmatique) qu’il est impossible de trouver la vérité. Seuls les sceptiques recherchent la vérité. Il existe donc, dit Sextus Empiricus, trois principaux types de philosophie : dogmatique, académique et sceptique. Diogène Laertius écrit qu'en plus du nom de « sceptiques » (de sk)eptomai, « considérer, enquêter »), ils étaient également appelés aporétiques (du mot « aporie »), dzétiques (de zht)ew, « à chercher ») et effektiki (de _ep)ecw, « retenir le jugement ») (D.L. IX, 70).
Sextus Empiricus trouve le début de la philosophie sceptique dans la capacité de l'homme à douter. Une personne doute parce qu’elle possède une capacité sceptique : « La capacité sceptique est celle qui oppose le phénomène au concevable de toutes les manières possibles ; par conséquent, en raison de l'équivalence des choses et des discours opposés, nous arrivons d'abord à l'abstinence de jugement (_epoc)h), puis à l'équanimité (_atarax0ia) » (Sextus Empiricus. Trois livres de propositions pyrrhoniennes, 8). « L'abstinence de jugement, poursuit Sextus, est un état d'esprit dans lequel on ne nie rien ni n'affirme rien » (Ibid., 10). Notons que Sextus parle de la capacité sceptique, et jamais de la capacité dogmatique, montrant qu'être sceptique et douter est naturel pour une personne, mais qu'être dogmatique n'est pas naturel.
Ainsi, la méthode du scepticisme consiste dans le fait que le sceptique essaie de considérer tous les phénomènes et tout ce qui est concevable, découvre que ces phénomènes et concepts peuvent être perçus de différentes manières, y compris le contraire, prouve qu'une contradiction surgit ainsi. qu'un jugement équivaudra à un autre jugement. En raison de l'équivalence des jugements sur des choses et des discours opposés, le sceptique décide de s'abstenir de juger quoi que ce soit, et parvient alors à l'équanimité - l'ataraxie, c'est-à-dire à ce que recherchaient les stoïciens. Chacune de ces étapes a été soigneusement élaborée par les sceptiques. La suspension du jugement est souvent désignée par le terme ancien « époque ».
Ainsi, la première tâche du pyrrhoniste est de tout opposer de la meilleure façon possible. Le sceptique oppose donc tout : le phénomène au phénomène, le phénomène au concevable, le concevable au concevable. À ces fins, Énesidème a développé dix méthodes d'argumentation, appelées. tropes, et Agrippa en a ajouté cinq autres. Les considérations de scepticisme se limitent souvent à ces tropes, et pour de bonnes raisons. Ils contiennent en effet les fondements du pyrrhonisme antique. Cependant, comme nous l’avons vu, ce type de raisonnement joue un rôle de soutien dans la réalisation de l’objectif plus important de l’ataraxie.
Le débat sur cette philosophie a surgi du vivant des sceptiques eux-mêmes ; on leur a reproché le fait que le scepticisme n'est pas viable : pour vivre et agir, il faut être fermement convaincu de quelque chose. Si vous doutez de tout, vous ne pouvez rien faire. Comme indiqué précédemment, Aristote a remarqué cette contradiction interne du scepticisme : « Et cela est particulièrement évident du fait qu'en réalité personne n'a de telles opinions : ni les autres, ni ceux qui expriment cette position. En effet, pourquoi une telle personne se rend-elle à Mégare, et ne reste-t-elle pas chez elle, en imaginant qu'elle s'y rend ? (Mét. 4, 4). Cependant, Sextus Empiricus écrit quelque chose de complètement opposé : le sceptique accepte sa philosophie pour ne pas rester complètement inactif (Sextus, 23). Un sceptique se concentre uniquement sur les phénomènes et refuse de connaître l’essence des choses. Ce qui est certain pour lui, c'est un phénomène. Comme le dit Timon : « Je ne prétends pas que le miel soit doux, mais j'avoue qu'il le semble » (D.L. IX, 105). Par conséquent, un sceptique agit en fonction de phénomènes et sans réfléchir à ce qu’il y a derrière eux, quelle est leur signification, etc. Le dogmatique, au contraire, affirme certaines dispositions sur l'essence de ces phénomènes, mais elles peuvent être erronées, ce qui montre la différence entre les écoles dogmatiques. Et que se passe-t-il si une personne commence à agir conformément à une philosophie erronée ? Cela entraînera des conséquences désastreuses. Si vous vous appuyez dans votre philosophie uniquement sur des phénomènes, sur ce qui est incontestable, alors votre activité aura une base solide.
Cette position de Sextus Empiricus a d’autres racines. A cette époque, il y avait trois écoles de médecine en Grèce : méthodologique, dogmatique et empirique. Le médecin Sextus appartenait à l’école des empiristes, comme son nom l’indique. Le célèbre médecin Galien appartiendra plus tard à la même école. Les empiristes ont soutenu qu'il n'est pas nécessaire de rechercher les origines des maladies, il n'est pas nécessaire de déterminer ce qu'il y a de plus chez une personne : la terre ou le feu, l'eau ou la bile, comme le suggéraient les médecins dogmatiques, mais il faut se laisser guider par l'expérience, regarder aux symptômes de la maladie et en soulager le patient. Lors du traitement des patients, cette méthode a donné de bons résultats, mais les médecins empiriques voulaient traiter non seulement le corps, mais aussi l'âme. La principale maladie de l'âme est le dogmatisme, car elle empêche une personne d'atteindre le bonheur et le dogmatisme doit donc être traité. Une personne doit être traitée pour ce sur quoi elle se trompe - afin que l'essence des choses puisse être connue.
Considérons les arguments sceptiques avancés par les pyrrhonistes. Tout d'abord, à propos des sentiers d'Enysidem. Il y en a dix, ils couvrent principalement le côté sensoriel de la cognition. Une liste de ces tropes est donnée par Diogène Laertius et Sextus Empiricus. L’ordre de présentation est quelque peu différent ; nous suivrons Sextus Empiricus.
Le premier trope repose sur la diversité des êtres vivants et de leurs capacités cognitives. Généralement, les philosophes soutiennent que le critère de la vérité est l'homme, c'est-à-dire il est la mesure de toutes choses (Protagoras) et lui seul peut connaître la vérité. Le sceptique demande à juste titre : pourquoi, en fait, une personne ? Après tout, une personne découvre le monde qui l’entoure à travers ses sens. Mais la diversité du monde animal montre que les animaux possèdent également des organes sensoriels et qu’ils sont différents des humains. Pourquoi pensons-nous que les sens humains fournissent une image plus fidèle du monde que les sens animaux ? Par exemple, « comment peut-on dire qu'au toucher, [les animaux] reçoivent la même impression à la fois de tortue et de chair nue, et dotée d'épines, et de plumes et d'écailleuses ? Et comment ceux dont l’organe auditif est très étroit et ceux dont l’organe auditif est très large, et ceux dont les oreilles sont velues et ceux dont les oreilles sont lisses, peuvent-ils recevoir la même perception de l’audition ? (Sextus, 49-50). Par conséquent, une personne n’a pas le droit de se considérer comme un critère pour connaître la vérité. « Si, selon la différence entre les êtres vivants, il existe différentes idées sur lesquelles il est impossible de juger, alors il faut s'abstenir de juger sur les objets extérieurs » (61).
Deuxième trope : le philosophe fait une hypothèse : supposons cependant que l’homme soit le critère de la vérité, « que les gens méritent plus de confiance que les animaux irrationnels » (79). Mais il y a beaucoup de gens et ils sont différents. Il y a des Scythes, des Grecs, des Indiens. Ils tolèrent différemment le froid et la chaleur, la nourriture est saine pour certains, nocive pour d’autres, etc. Les gens sont divers et il est donc impossible de dire quelle personne en particulier perçoit correctement les objets extérieurs.
Troisième trope : même si nous supposons qu'il est possible de trouver une personne qui est le critère de vérité, alors cela n'aidera pas à connaître l'essence d'une chose. Après tout, chaque personne possède de nombreux sens qui peuvent donner une image différente du monde qui l’entoure. « Certaines personnes pensent que le miel a un goût sucré, mais qu’il semble désagréable. Il est donc impossible de dire si c’est vraiment doux ou désagréable » (92). Une personne n'a que cinq organes sensoriels, et il est possible que certaines qualités des objets ne soient perçues par aucun de ces organes, tout comme une personne aveugle de naissance ne sait rien des couleurs, et une personne sourde ne sait pas. tout ce qui concerne les sons.
Quatrième trope : un même objet peut être perçu différemment dans des circonstances différentes, dans des situations différentes, « selon l'âge, le mouvement ou le repos, la haine ou l'amour, la malnutrition ou la satiété, l'ivresse ou la sobriété » (100) . Par exemple, pour un amant, une femme semble belle, pour un autre, ordinaire. "Le vin semble aigre à ceux qui ont déjà mangé des dattes ou des figues, et doux à ceux qui ont déjà mangé des noix ou des pois." Cela implique également l'abstention de jugement.
Le cinquième trope parle de dépendance à l’égard de la position, des distances et des lieux. Par exemple, une tour paraît petite de loin, mais grande de près. La même flamme de lampe est faible au soleil et brillante dans l’obscurité. Le corail dans la mer est mou, mais dans l’air, il est dur. On peut seulement dire comment un objet apparaît en relation avec une position, une distance ou un lieu particulier ; ce qu'il est par nature ne peut être connu.
Le sixième trope « dépend du mélange », écrit Sextus (124). Aucun objet ou phénomène n'est perçu seul, isolément, mais toujours en conjonction avec quelque chose. Par exemple, « le même son semble différent lorsqu’il est combiné avec de l’air raréfié, et différent lorsqu’il est combiné avec de l’air épais » (125). Les arômes sont plus enivrants dans un bain public que dans l'air ordinaire, etc. Par conséquent, à cause des impuretés, les sens ne perçoivent pas l’essence exacte des objets extérieurs. La conclusion est la même : s’abstenir de juger.
Le septième trope « concerne les relations de taille et de structure des objets sujets » (120). Un même objet peut avoir un aspect différent selon qu'il est grand ou petit, qu'il est divisé en plusieurs parties ou qu'il est entier. Par exemple, « les grains de sable, séparés les uns des autres, semblent durs, mais rassemblés en tas, ils produisent une sensation douce », « la limaille d'argent par elle-même semble noire, mais ajoutée au tout, elle apparaît blanche » ; « le vin, consommé avec modération, nous fortifie, et bu avec excès, détend le corps », etc.
Le huitième trope « parle d'une attitude envers quelque chose » (135). Le sceptique soutient « que puisque tout existe par rapport à quelque chose, alors nous nous abstiendrons de dire ce que c’est dans l’isolement et dans sa nature ». Par exemple, quiconque porte un jugement sur quelque chose le dit par rapport à lui-même, à ses sentiments, à sa façon de penser, etc. Et en général, tout existe « par rapport à tel mélange, telle méthode, telle composition, telle taille et telle position ».
Le neuvième trope concerne quelque chose qui est constamment ou rarement rencontré. « Le soleil, bien sûr, devrait nous frapper bien plus qu'une comète », écrit Sextus Empiricus, « mais comme nous voyons le soleil constamment, et la comète rarement, nous sommes tellement frappés par la comète que nous la considérons même comme une comète divine. signe, mais nous ne sommes pas du tout frappés par le soleil. »(141). Ce qui arrive moins souvent nous étonne plus que ce qui arrive souvent, même s’il s’agit par essence d’un événement très ordinaire.
Le dixième trope est associé à la question de la moralité et dépend du comportement, des coutumes, des lois, des croyances et des dispositions dogmatiques des différents peuples. Sextus donne des exemples où il montre que différents peuples ont leurs propres idées sur le bien et le mal, sur le décent et l'indécent, sur différentes croyances religieuses, lois et coutumes. Par exemple, « certains Éthiopiens tatouent les petits enfants, mais pas nous ; et les Perses considèrent qu'il est décent de porter des vêtements longs, multicolores et longs jusqu'aux orteils, mais pour nous, c'est indécent », etc.
Comme on peut le voir ci-dessus, les chemins d’Énésidème marquent l’auto-contradiction de la connaissance sensorielle et sont donc une réponse à l’épistémologie sensualiste. Mais le rationalisme, selon les sceptiques, ne peut pas nous conduire à la vérité, et les chemins d'Agrippa en parlent.
Le premier trope concerne l’incohérence. Cela témoigne du fait qu'il existe une grande variété de systèmes philosophiques, que les gens ne peuvent pas s'entendre et trouver la vérité, il s'ensuit que s'il n'y a toujours pas d'accord sur quoi que ce soit, alors nous devons nous abstenir de juger pour l'instant.
Le deuxième trope concerne l’éloignement vers l’infini. Sur cette base, le sceptique argumente : tout ce que nous apportons pour prouver la vérité d'une certaine position doit également être prouvé si nous le considérons comme vrai, et cela, à son tour, doit également être prouvé, etc. Ainsi, une chaîne sans fin de preuves se construit, nous ne savons pas par où commencer la justification, et donc nous nous abstenons de porter un jugement.
Le troisième trope est appelé « relatif à quoi », dans lequel la chose sujet nous apparaît comme l'une ou l'autre par rapport à celui qui juge l'objet ou le contemple, et à l'objet contemplé ou connu lui-même. Dans la cognition d'un objet, le sujet de la cognition participe toujours ; il n'y a pas de sujet sans objet et vice versa. Lorsque nous jugeons quelque chose, nous interférons avec ce que nous jugeons et nous ne pouvons donc pas juger l'objet en lui-même, puisqu'il n'existe pas en lui-même, mais n'existe que pour nous.
Le quatrième trope concerne les hypothèses. Si un philosophe veut éviter d’aller vers l’infini, alors il suppose dogmatiquement qu’une proposition est vraie en soi. Mais le sceptique n'accepte pas une telle concession, estimant qu'il s'agit précisément d'une concession, la position est acceptée sans preuve et ne peut donc prétendre être vraie.
Le cinquième trope concerne l’interprouvabilité : afin d’éviter l’infini dans la preuve, les philosophes tombent souvent dans l’erreur de l’interprouvabilité. Une position est justifiée à l’aide d’une autre, qui à son tour est justifiée à l’aide de la première.
Les sceptiques utilisent toutes ces voies lorsqu'ils examinent toute question philosophique, à laquelle sont consacrées toutes les autres pages des livres de Sextus Empiricus. Sextus prouve qu'il faut s'abstenir de tout jugement sur les questions relatives au critère du bien et du mal, à la connaissance de la vérité, à l'existence de Dieu ou des dieux, à l'existence des causes et des effets, à l'heure et au lieu, à la définition et à la preuve, etc. . Par exemple, le problème de la causalité : la cause existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas ? Premièrement, Sextus Empiricus prouve qu'une cause existe, car il est difficile de supposer qu'il y ait un effet sans sa cause, alors tout serait dans un désordre complet. Mais il prouve de manière non moins convaincante qu’il n’y a aucune raison. Car avant de concevoir une action, il faut savoir qu'il y a une cause qui donne naissance à cette action ; et pour savoir qu'il y a une cause, nous devons savoir qu'il y a une action dont elle est la cause, c'est-à-dire nous ne pouvons penser ni à la cause ni à l’effet séparément ; ils sont corrélés les uns aux autres. Par conséquent, pour concevoir la cause, il faut d’abord connaître l’effet, et pour connaître l’effet, il faut d’abord connaître la cause. De cette preuve mutuelle il résulte que nous ne pouvons connaître ni la cause ni l'effet. De plus, pour chaque cause, il doit y avoir une cause pour cette cause, et ainsi de suite à l’infini. Autre argument : soit la cause coexiste avec l’effet, soit elle le précède. Mais si la cause existe avant l’action, alors elle n’est pas la cause de cette action, parce que la raison est directement liée à l’action ; La cause ne peut pas être simultanée à l’action, car l’action se produit après la cause. Ainsi, puisqu’il peut être prouvé qu’il y a une cause et qu’il n’y en a pas, il est nécessaire de suspendre son jugement sur cette question.
Quelques mots sur la façon dont le scepticisme ancien a interagi avec le christianisme émergent. Pouvons-nous dire que le scepticisme a entravé ou favorisé la propagation du christianisme ? Certains historiens de la philosophie pensent que le scepticisme antique a préparé le terrain pour que la graine du christianisme tombe sur un sol favorable grâce à la prédication des apôtres. Opinions sceptiques dans les premières années après Jésus-Christ. étaient si courants parmi les penseurs anciens que toute affirmation pouvait être perçue comme tout à fait possible. Le scepticisme a préparé le monde antique à dire : « Je crois parce que c’est absurde. » Par conséquent, nous pouvons dire que le scepticisme a joué un rôle préparatoire à la propagation du christianisme en Europe, détruisant l'ancienne confiance uniquement dans la raison.
L'attitude des théologiens chrétiens envers le scepticisme variait. D'une part, le premier écrivain chrétien Lactance considérait le scepticisme comme une bonne introduction au christianisme, car le scepticisme montre la faiblesse de notre esprit, il prouve que l'esprit ne peut pas connaître la vérité par lui-même, cela nécessite une révélation. Par contre, béni. Augustin prouve que le scepticisme n'est pas la vraie philosophie, il détruit la foi en l'existence de la vérité, et puisque Dieu est la vérité, le scepticisme conduit à l'athéisme. Par conséquent, selon le bienheureux. Augustin, une lutte acharnée contre le scepticisme est nécessaire. Les Pères orientaux de l’Église étaient plutôt froids à l’égard du scepticisme. St. Grégoire le Théologien et le Patriarche Photius montrent leur familiarité avec les idées des anciens sceptiques, mais ne commentent en aucun cas leurs points de vue. Cette divergence d'attitude à l'égard du scepticisme de la part des théologiens occidentaux et orientaux est peut-être due au fait que les chrétiens occidentaux ont connu le scepticisme en latin, grâce à Cicéron, qui était académicien, c'est-à-dire un dogmatique qui niait la connaissance de la vérité ; Les chrétiens orientaux lisaient en grec les œuvres des pyrrhonistes Enesidème (même un résumé des travaux d'Enesidème, réalisé par saint Photius, a été conservé) et Sextus Empiricus, qui n'ont pas exprimé une attitude aussi négative envers la possibilité de connaître la vérité. .
Le scepticisme de Pyrrhon
Le fondateur du scepticisme antique, Pyrrhon (365-275 av. J.-C.), considérait un philosophe comme celui qui aspire au bonheur. Mais le bonheur consiste en l’équanimité et l’absence de souffrance. Celui qui veut atteindre le bonheur ainsi compris doit répondre à trois questions : De quoi sont faites les choses ? Comment faut-il traiter ces choses ? Quel bénéfice tirerons-nous de cette relation avec eux ? À la première question, selon Pyrrhon, aucune réponse ne peut être obtenue : tout « n’est-ce que cela ». Rien ne doit donc être qualifié de beau ou de laid, ni de juste ou d’injuste. Toute affirmation sur n’importe quel sujet peut être combattue avec la même force et avec le même droit par quelque chose qui la contredit. Puisqu'aucune déclaration vraie n'est possible sur aucun objet, Pyrrhon appelle alors l'abstinence (« Epoche ») de tout jugement à leur sujet la seule attitude appropriée envers les choses pour un philosophe. Mais une telle abstinence de jugement n’est pas un agnosticisme complet ; certainement Fiables, selon Pyrrhon, les perceptions ou impressions sensorielles et les jugements tels que « Cela me semble amer ou doux » seront vrais. Une erreur naît que lorsque celui qui porte un jugement essaie de passer de ce qui semble être à ce qui existe « en vérité », c'est-à-dire qu'à partir du phénomène, il tire une conclusion sur sa véritable base (essence) : seul celui qui prétendre que cette chose n'est pas vraie se trompera, cela lui semble seulement amer (doux), mais c'est en vérité ce qu'il semble. La réponse à la deuxième question de la philosophie, selon Pyrrhon, détermine la réponse à sa troisième question - le résultat, ou le bénéfice, de l'abstinence obligatoire pour le sceptique de tout jugement sur la vraie nature des choses, suit l'équanimité, la sérénité, qui le scepticisme considère comme le but le plus élevé du bonheur accessible au philosophe. Cependant, s'abstenir de jugements dogmatiques ne signifie pas du tout une inactivité pratique totale du philosophe : celui qui vit doit agir, et le philosophe est comme tout le monde. Mais le philosophe sceptique diffère de tout le monde en ce qu'il n'attache pas à sa façon de penser et d'agir (qu'il a appris, comme tout le monde, des coutumes et de la morale) le sens de vérités inconditionnelles.
Philosophie d'Épicure
Épicure (342-271 av. J.-C.), créateur de la doctrine matérialiste (qui portera plus tard son nom), comprenait également la philosophie comme une activité qui permet aux gens, par la réflexion et la recherche, de parvenir à une vie sereine et sans souffrance : « Que personne dans son la jeunesse ne retarde pas l'étude de la philosophie, et dans la vieillesse ne se lasse pas d'étudier la philosophie... Celui qui dit que le moment n'est pas encore venu ou est passé d'étudier la philosophie est comme celui qui dit qu'il n'y a pas encore ou ce n’est plus l’heure du bonheur. La section principale (« partie ») de la philosophie est donc l'éthique, qui est précédée par la physique (selon Épicure, elle révèle dans le monde ses principes naturels et leurs connexions, libérant ainsi l'âme de la croyance aux puissances divines, au destin ou au destin). destin qui pèse sur l'homme), et il est à son tour précédé de la troisième « partie » de la philosophie - le canon (la connaissance est le critère de la vérité et les règles de sa connaissance). En fin de compte, Épicure conclut : les critères de connaissance sont les perceptions sensorielles et les idées générales qui en découlent ; en épistémologie, cette orientation est appelée sensualisme (du latin sensus sentiment).
L'image physique du monde, selon Épicure, est la suivante. L’univers est constitué de corps et d’espace, « c’est-à-dire de vide ». Les corps représentent soit des composés de corps, soit ce à partir duquel les composés sont formés, et ce sont des corps denses indivisibles et non coupés - des atomes ; qui diffèrent non seulement, comme chez Démocrite, par la forme et la taille, mais aussi par le poids. Les atomes se déplacent éternellement à la même vitesse pour tout le monde et, contrairement aux vues de Démocrite, peuvent spontanément s'écarter de la trajectoire de ce qui se passe en raison de la nécessité d'un mouvement rectiligne. Épicure introduit l'hypothèse de l'auto-déviation des atomes pour expliquer les collisions entre atomes et interprète cela comme un minimum de liberté qui doit être supposé dans les éléments du micromonde - dans les atomes, afin d'expliquer la possibilité de liberté dans la vie humaine.
Le scepticisme est une philosophie qui, dans ses principes, s'oppose au dogmatisme. De toute évidence, cette science a été créée grâce au fait que certains scientifiques anciens avaient accumulé de nombreuses plaintes contre les courants qui existaient déjà à cette époque.
L'un des premiers représentants du scepticisme, Empiriste, a expliqué dans son ouvrage philosophique que dans ce sens, essentiellement, les principaux outils de la pensée sont la comparaison des données de l'esprit et des données des sens, ainsi que l'opposition de celles-ci. données les unes aux autres. Les sceptiques remettaient en question la qualité même de la pensée, en particulier l'existence et la fiabilité des dogmes - des vérités qui devraient être tenues pour acquises et ne devraient nécessiter aucune preuve pour elles-mêmes.
Cependant, le scepticisme en tant que direction de la science philosophique ne considère pas du tout le doute comme un principe fondamental - il l'utilise uniquement comme arme polémique contre les partisans des dogmes. La philosophie du scepticisme professe un tel principe comme phénomène. De plus, il faut clairement distinguer le scepticisme ordinaire (quotidien), scientifique et philosophique.
Au quotidien, le scepticisme peut s’expliquer par l’état psychologique d’une personne, son incertitude situationnelle, son doute sur quelque chose. Un sceptique s’abstient toujours de porter des jugements catégoriques.
Le scepticisme scientifique est une opposition claire et cohérente aux scientifiques qui ne se sont pas appuyés sur des preuves empiriques dans leurs jugements. Cela s'applique en particulier aux axiomes - des théorèmes qui ne nécessitent pas de preuve.
Le scepticisme en philosophie est une direction dont les adeptes, comme indiqué ci-dessus, expriment des doutes quant à l'existence de connaissances fiables. Dans sa forme modérée, les sceptiques se limitent uniquement à la connaissance des faits et font preuve de retenue par rapport à toutes les hypothèses et théories. Pour eux, la philosophie, y compris celle qu’ils suivent, est quelque chose comme la poésie scientifique, mais pas la science dans sa forme pure. C’est à cela que se rattache la célèbre affirmation : « La philosophie n’est pas une science !
Le scepticisme en philosophie : comment la direction s'est développée
L’histoire du scepticisme représente un déclin, un épuisement progressif. Cette tendance est née dans la Grèce antique, a joué un rôle très mineur et a été relancée à l'époque de la Réforme (lors de la restauration de la philosophie grecque), lorsque le scepticisme a dégénéré en des formes plus douces de nouvelle philosophie, telles que le subjectivisme et le positivisme.
Le scepticisme en philosophie : les représentants
Le fondateur de l'école grecque des sceptiques est considéré comme Pyrrhon, qui, selon certaines opinions, aurait étudié en Inde. En outre, l'ancien scepticisme en tant que réponse au dogmatisme métaphysique est représenté par des philosophes tels qu'Arcesilas (académie intermédiaire) et les sceptiques dits « tardifs » Agrippa, Sextus Empiricus, Aenesidemus. En particulier, Aenesidemus a indiqué à un moment donné dix tropes (principes) de scepticisme. Les six premiers représentent la différence entre les personnes, les états individuels, les êtres vivants, les positions, les lieux, les distances, les phénomènes et leurs connexions. Les quatre derniers principes sont l'existence mixte d'un objet perçu avec d'autres, la relativité en général, la dépendance à un certain nombre de perceptions, la dépendance aux lois, à la morale, au niveau d'éducation, aux opinions religieuses et philosophiques.
Les représentants les plus importants du scepticisme du Moyen Âge sont D. Hume et M. Montel.
Scepticisme en philosophie : critique
Le scepticisme a été critiqué en particulier par Lewis Vaughn et Theodore Schick, qui ont écrit que puisque les sceptiques ne sont pas sûrs que la connaissance nécessite la certitude, comment peuvent-ils savoir qu'il en est réellement ainsi. Il est logique qu’ils ne puissent pas le savoir. Cette question a donné de sérieuses raisons de douter de l'affirmation du scepticisme selon laquelle la connaissance nécessite nécessairement la certitude. Mais on peut non seulement douter du scepticisme, mais aussi le remettre en question dans son ensemble. Mais comme notre réalité n'est pas seulement constituée de lois logiques (il y a une place dans notre vie pour des paradoxes insolubles et inexplicables), ils ont préféré écouter de telles critiques avec prudence, car « il n'y a pas de sceptiques absolus, donc ce n'est pas du tout Il est nécessaire qu’un sceptique doute des choses évidentes.
La philosophie du scepticisme antique a existé pendant assez longtemps et a été le mouvement le plus influent en philosophie pendant de très nombreux siècles - à partir du 4ème siècle avant JC. à 3-4 siècles après R.H. Le fondateur du scepticisme antique est traditionnellement considéré comme le philosophe Pyrrhon et son élève Timon. Par la suite, le scepticisme de type pyrrhonien s'estompe quelque peu et la soi-disant Académie platonicienne apparaît. le scepticisme académique avec des représentants tels que Carnéade et Arcésilas - nous sommes au IIe siècle avant JC. Le scepticisme pyrrhonien est relancé, ce qu'on appellera plus tard le pyrrhonisme, par Énésidème et Agrippa (les œuvres de ces philosophes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour). Le représentant du scepticisme de l'Antiquité tardive est le philosophe et médecin Sextus Empiricus, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ. Aux IIIe et IVe siècles, l'école existait encore et des éléments de scepticisme se retrouvent chez le médecin Galien.
Quelques mots sur la vie du fondateur du scepticisme antique - Pyrrhon. Il est né en 270 avant JC et a vécu 90 ans. Pyrrhon fait partie de ces philosophes qui n'ont pas écrit de traités philosophiques, comme Socrate, montrant à travers sa vie la philosophie qu'il a développée. Nous le connaissons grâce au livre de Diogène Laertius. Le chapitre sur Pyrrhon est la principale source d'informations sur le pyrrhonisme. Nous en apprenons qu'il s'est abstenu de tout jugement, c'est-à-dire il avait des doutes sur la connaissance du monde. Et Pyrrhon, étant un philosophe cohérent, s'est efforcé toute sa vie d'être un partisan de cet enseignement. Comme le souligne Diogène Laertius, Pyrrhon ne s'éloignait de rien, ne reculait devant rien, était exposé à tout danger, qu'il s'agisse d'une charrette, d'un bûcher ou d'un chien, sans être exposé à aucun sentiment de danger ; il était protégé par ses amis qui le suivaient. C’est une affirmation plutôt audacieuse, car elle contredit l’essence de la philosophie sceptique. Diogène rapporte en outre qu'au début Pyrrhon s'occupait de la peinture ; un tableau a été conservé, peint plutôt médiocrement. Il vivait dans la solitude, se montrant rarement même à la maison. Les habitants d'Élide le respectaient pour son intelligence et l'élu grand prêtre, ce qui suscite quelques réflexions. Encore une fois, il n’est pas clair comment une personne, étant un sceptique extravagant et convaincu, pourrait devenir grand prêtre. De plus, pour lui, il fut décidé d'exonérer tous les philosophes d'impôts. Plus d'une fois, il a quitté la maison sans en parler à personne et s'est promené avec n'importe qui. Un jour son ami Anaxarchus tomba dans un marécage, Pyrrhon passa sans lui serrer la main. Tout le monde le grondait, mais Anaxarchus le félicitait. Il vivait avec sa sœur, sage-femme, et allait au marché pour vendre des poulets et des porcelets.
Un incident célèbre est mentionné par Diogène Laertius : alors que Pyrrhon naviguait sur un navire et qu'il était pris dans une tempête avec ses compagnons, tout le monde commença à paniquer, seul Pyrrhon seul, désignant le cochon du navire, qui aspirait sereinement de son à travers, a dit que c'est exactement ainsi qu'un vrai homme devrait se comporter.
On sait peu de choses sur Timon, l'élève de Pyrrhon, seulement qu'il était poète et exprimait sa vision du monde sous forme de programmes. Par la suite, des idées sceptiques ont commencé à se développer au sein de l’Académie de Platon. Les étudiants de Platon ont développé les enseignements de Platon à leur manière. Carnéade et Arcésilas, se considérant comme de vrais platoniciens, ont commencé à développer le thème de la critique du sensationnalisme et sont arrivés à la conclusion que la vérité est inconnaissable. De Carnéade et d'Arcésilas, rien ne nous est non plus parvenu. L’ancien orateur et philosophe romain Cicéron est un partisan du scepticisme académique. Il a publié un certain nombre d'ouvrages dans lesquels il présente son point de vue sur les sceptiques universitaires. Nous pouvons également nous familiariser avec le scepticisme académique dans l’œuvre de Bienheureux. "Contre les académiciens" d'Augustin, où il critique leur enseignement.
Le pyrrhonisme fut ensuite relancé par Énésidème et Agrippa, puis par Sextus Empiricus, un systématiseur et peut-être le représentant le plus talentueux du pyrrhonisme.
Je recommande la lecture des ouvrages de Sextrem Empiricus en 2 volumes, éd. 1976 Il écrit 2 ouvrages : l’un est « Trois livres de propositions de Pyrrhon », l’autre est « Contre les savants ». Le scepticisme antique, comme toute la philosophie hellénistique, posait avant tout des questions éthiques, considérant la principale solution au problème de savoir comment vivre dans ce monde, comment parvenir à une vie heureuse. On pense généralement que le scepticisme est avant tout un doute sur la connaissabilité de la vérité, et ils réduisent le scepticisme uniquement à la théorie de la connaissance. Or, cela n’est pas du tout vrai en ce qui concerne le pyrrhonisme. Sextus Empiricus divise toutes les écoles philosophiques en 2 classes : dogmatiques et sceptiques. Il divise également les dogmatiques en dogmatiques et académiciens. Les dogmatiques et les académiciens croient avoir déjà tranché la question de la vérité : les dogmatiques, c'est-à-dire les adeptes d’Aristote, d’Épicure, des stoïciens, etc. prétendent avoir trouvé la vérité, et les universitaires prétendent (également de manière dogmatique) qu’il est impossible de trouver la vérité. Seuls les sceptiques recherchent la vérité. Ainsi, comme le dit Sextus Empiricus, il existe trois principaux types de philosophie : dogmatique, académique et sceptique. Diogène Laertius écrit qu'en plus du nom « sceptiques » - du mot « surveiller », ils étaient également appelés aporétiques (du mot « aporie »), dzétiques (du mot « chercher ») et effektiki (c'est-à-dire sceptiques).
Comme l’a souligné Sextus Empiricus, l’essence de la philosophie sceptique se résume à ce qui suit. "La capacité sceptique est celle qui oppose, de la seule manière possible, un phénomène à un phénomène concevable, à partir de là, en raison de l'équivalence de choses et de discours opposés, nous arrivons d'abord à l'abstinence de jugement, et ensuite à l'équanimité." Je remarque que Sextus parle de la capacité sceptique, et jamais de la capacité dogmatique, montrant qu'être sceptique est naturel pour une personne, mais qu'être dogmatique n'est pas naturel. Au début, les sceptiques essaient de considérer tous les phénomènes et tout ce qui est imaginable, découvrent que ces phénomènes et concepts peuvent être perçus de différentes manières, y compris le contraire, prouvent qu'ainsi tout le monde se contredira, de sorte qu'un jugement équilibrera un autre jugement. . En raison de l'équivalence des jugements dans les choses et les discours opposés, le sceptique décide de s'abstenir de juger quoi que ce soit, et alors le sceptique parvient à l'équanimité - attarxia, c'est-à-dire à ce que recherchaient les stoïciens. Et chacune de ces étapes a été soigneusement élaborée par les sceptiques. L'abstinence de jugement est aussi appelée « époque ».
Ainsi, la première tâche du pyrrhoniste est de tout opposer de toutes les manières possibles. Le sceptique oppose donc tout : le phénomène au phénomène, le phénomène au concevable, le concevable au concevable. À ces fins, Aenesidemus a développé 10 tropes et Agrippa cinq autres. Les considérations de scepticisme se limitent souvent à ces tropes, et pour de bonnes raisons. Voilà en effet les fondements du pyrrhonisme antique. Mais avant d'envisager les voies, essayons de comprendre s'il est vraiment possible de vivre selon la philosophie du scepticisme antique ?
La controverse autour de cette philosophie est née du vivant des sceptiques eux-mêmes : on leur a reproché que leur philosophie n'était pas viable, qu'elle n'avait pas de guide de vie. Parce que pour vivre, il faut accepter quelque chose comme vérité. Si vous doutez de tout, alors, comme le disait Aristote, une personne se rendant à Mégare ne l'atteindra jamais, car au moins vous devez être sûr que Mégare existe.
Pascal, Arno, Nicole, Hume et d'autres philosophes des temps modernes ont reproché de tels péchés au scepticisme. Cependant, Sextus Empiricus écrit quelque chose de complètement opposé - que le sceptique accepte sa philosophie pour ne pas rester inactif, car c'est la philosophie dogmatique qui conduit une personne à l'inactivité, seul le scepticisme peut servir de guide dans la vie et l'activité. Un sceptique se concentre avant tout sur les phénomènes, refuse de connaître l'essence des choses, car il n'en est pas sûr, il la cherche. Ce qui est certain pour lui, c'est un phénomène. Comme le disait Pyrrhon : Je suis sûr que le miel me semble doux, mais je m'abstiens de juger qu'il est doux par nature.
Le dogmatique, au contraire, affirme certaines propositions sur l'essence des choses, mais il est évident qu'elles peuvent être erronées, ce qui montre la différence entre les écoles dogmatiques. Et que se passe-t-il si une personne commence à agir conformément à une philosophie erronée ? Cela entraînera des conséquences désastreuses. Si nous nous appuyons dans notre philosophie uniquement sur des phénomènes, uniquement sur ce que nous savons sans aucun doute, alors toutes nos activités auront une base solide.
Cette position de Sextus Empiricus a d’autres racines. Au Ier siècle après R.H. En Grèce, il y avait trois écoles de médecine : méthodologique, dogmatique et empirique. Le médecin Sextus appartenait à l’école des empiristes, d’où son nom « Empiriste ». Le docteur Galen appartenait à la même école. Ces médecins ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de rechercher les origines des maladies, il n'est pas nécessaire de déterminer ce qu'il y a de plus chez une personne : la terre ou le feu, il n'est pas nécessaire de mettre les quatre éléments en harmonie. Mais il faut examiner les symptômes et soulager le patient de ces symptômes. Lors du traitement des patients, cette méthode a donné de bons résultats, mais les médecins empiriques voulaient traiter non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les principales maladies de l'âme sont le dogmatisme et l'académisme, car elles empêchent une personne d'atteindre le bonheur, et le dogmatisme doit être traité. Une personne doit être traitée pour ce sur quoi elle se trompe, et elle se trompe sur le fait qu'il est possible de connaître l'essence des choses. Il faut lui montrer que c'est faux, montrer que la vérité se cherche en faisant confiance au phénomène. Dans le chapitre « Pourquoi un sceptique présente-t-il des arguments faibles ? » Sextus Empiricus écrit à ce sujet. En effet, quand on lit ses œuvres, on y voit souvent des arguments faibles, voire parfois drôles. Sextus Empiricus lui-même le sait et dit que les sceptiques le font délibérément - disent-ils, l'un peut être convaincu par un argument faible, l'autre doit construire un système philosophique solide. L'essentiel est l'objectif, la réalisation du bonheur. Cependant, par souci d’équité, il faut reconnaître que les sceptiques disposent de très peu d’arguments faibles.
Examinons donc les arguments sceptiques avancés par Sextus Empiricus. Tout d'abord, à propos des sentiers d'Enysidem. Il y en a dix, ils captent principalement le côté sensoriel de la cognition, et les cinq voies d'Agrippa couvrent le domaine rationnel.
Le premier trope est basé sur la diversité des êtres vivants et dit ce qui suit. Les philosophes prétendent que le critère de la vérité est l'homme, c'est-à-dire il est la mesure de toutes choses (Protagoras) et lui seul peut connaître la vérité. Le sceptique demande à juste titre : pourquoi, en fait, une personne ? Après tout, une personne découvre le monde qui l’entoure à travers ses sens. Mais la diversité du monde animal montre que les animaux possèdent également des organes sensoriels et qu’ils sont différents des humains. Pourquoi pensons-nous que les sens humains fournissent une image plus fidèle du monde que ceux des autres animaux ? Comment ceux qui ont un organe auditif étroit et ceux qui ont un organe auditif large, ceux qui ont les oreilles velues et ceux qui ont les oreilles lisses, peuvent-ils entendre de la même manière ? Et nous n’avons pas le droit de nous considérer comme le critère de la vérité. Nous devons donc nous abstenir de tout jugement, car... Nous ne savons pas à qui faire confiance.
Deuxième trope : le philosophe fait une hypothèse (rétrécissant la question) : disons qu’une personne est le critère de vérité. Mais il y a beaucoup de gens et ils sont différents. Il y a des Scythes, des Grecs, des Indiens. Ils tolèrent différemment le froid et la chaleur ; la nourriture est saine pour certains et nocive pour d’autres. Les gens sont divers et il est donc impossible de dire quelle personne en particulier est le critère de vérité.
Le troisième trope restreint encore davantage la portée de l’exploration. Le sceptique suppose que nous avons trouvé une personne qui est le critère de la vérité. Mais il possède de nombreux sens qui peuvent donner une image différente du monde qui l'entoure : le miel a un goût sucré mais est désagréable à regarder, l'eau de pluie est bonne pour les yeux, mais les voies respiratoires en deviennent plus grossières, etc. - cela implique aussi l'abstinence de jugements sur l'environnement.
Le quatrième trope concerne les circonstances. Disons qu'il existe un organe sensoriel auquel nous pouvons faire le plus confiance, mais il y a toujours certaines circonstances : il y a des larmes dans les yeux qui affectent plus ou moins l'idée de l'objet visible, un état d'esprit inégal : pour un amoureux, une femme semble belle, pour un autre, rien de spécial. Le vin semble aigre si vous mangez des dattes avant, et si vous mangez des noix ou des pois, alors il semble sucré, etc. Cela implique également l'abstention de jugement.
Le cinquième trope concerne la dépendance à l’égard de la position, des distances et des lieux. Par exemple, une tour paraît petite de loin, mais grande de près. La même flamme de lampe est faible au soleil et brillante dans l’obscurité. Le corail dans la mer est mou, mais dans l’air, il est dur. Les faits nous obligent encore une fois à nous abstenir de porter des jugements sur ce qu'est un sujet dans son essence.
Le sixième trope dépend des mélanges, écrit Sextus. Nous ne percevons jamais un phénomène en soi, mais seulement en conjonction avec quelque chose. Il s'agit toujours d'air, d'eau ou d'un autre milieu. Le même son est différent dans l'air raréfié ou épais, les arômes sont plus enivrants dans un bain public que dans l'air ordinaire, etc. Même conclusion que précédemment.
Le septième trope concerne la taille et la structure des objets sujets. Un même objet peut avoir un aspect différent selon qu'il est grand ou petit, qu'il est divisé en plusieurs parties ou qu'il est entier. Par exemple, la limaille d'argent seule apparaît noire, mais ensemble, elles apparaissent blanches ; le vin consommé avec modération nous fortifie, et en excès détend le corps, etc.
Le huitième trope concerne l’attitude envers quelque chose. Cela fait écho au sixième. Le sceptique soutient que puisque tout existe en relation avec quelque chose, alors nous nous abstiendrons de dire quelle est sa nature distincte.
Le neuvième trope concerne quelque chose qui est constamment ou rarement rencontré. Le soleil devrait bien sûr nous frapper davantage, écrit Sextus Empiricus, mais depuis... Nous le voyons tout le temps, mais voyons rarement une comète, alors nous sommes tellement émerveillés par la comète que nous la considérons comme un signe divin, mais nous ne sommes pas du tout surpris par le soleil. Ce qui se produit moins souvent nous étonne, même si l’événement est au fond très ordinaire.
Le dixième trope est associé à la question de la moralité et dépend des croyances et des positions dogmatiques des différents peuples et de leurs coutumes. Sextus donne des exemples où il montre que différents peuples ont leurs propres idées sur le bien et le mal. Certains Éthiopiens tatouent les petits enfants, mais pas nous. Les Perses considèrent qu'il est décent de porter des vêtements longs et colorés, mais ici ce n'est pas le cas, etc.
Voici les sentiers d'Agrippa. Le premier trope concerne l’incohérence. Cela témoigne qu'il existe une grande variété de systèmes philosophiques, que les gens ne peuvent pas s'entendre et trouver la vérité, il s'ensuit que s'il n'y a toujours pas d'accord, alors nous devons retenir notre jugement pour l'instant.
Le deuxième trope concerne l’éloignement vers l’infini. Sur cette base, le sceptique soutient que pour prouver quelque chose, il faut se baser sur une affirmation qui doit également être prouvée, il faut la prouver sur la base d'une autre affirmation, qui à son tour doit également être prouvée, etc. - on va à l'infini, c'est à dire nous ne savons pas par où commencer la justification ; Nous nous abstenons de tout jugement.
Le troisième trope est appelé « relatif à quoi », dans lequel la chose sujet nous apparaît comme l'une ou l'autre par rapport à celui qui juge et contemple l'objet. Celui qui juge un objet est à la fois sujet et objet de connaissance. Lorsque nous jugeons quelque chose, nous intervenons dans le processus de cognition, nous ne pouvons donc pas juger l'objet en lui-même, car il n'existe pas en soi, mais n'existe que pour nous.
Le quatrième trope concerne les hypothèses. Si un philosophe veut éviter d’aller vers l’infini, alors il suppose dogmatiquement qu’une proposition est vraie en soi. Mais le sceptique n'accepte pas une telle concession, estimant qu'il s'agit précisément d'une concession, la position est acceptée sans preuve et ne peut donc prétendre être vraie.
Le cinquième trope est l’interprouvabilité, qui stipule que pour éviter l’infini dans la preuve, les philosophes tombent souvent dans l’erreur de l’interprouvabilité. Une position est justifiée à l’aide d’une autre, qui, à son tour, est justifiée à l’aide de la première.
Les sceptiques utilisent toutes ces voies lorsqu’ils examinent n’importe quelle question philosophique. Les sceptiques se disputaient avec leurs contemporains, leurs principaux adversaires étaient les stoïciens. Dans les livres de Sextus Empiricus, il y a des objections aux éthiciens, rhéteurs, géomètres, astrologues (les arguments de ce livre se retrouveront dans les ouvrages des Pères de l'Église). Ici, par exemple, se pose le problème de la causalité. En particulier, Sextus Empiricus se pose la question : une cause existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas ? Au début, il prouve qu'il y a une cause, car il est difficile de supposer qu'il y ait un effet sans sa cause, alors tout serait dans un désordre complet. Mais il prouve de manière non moins convaincante qu’il n’y a aucune raison. Car avant de penser à une action, nous devons savoir qu'il y a une cause qui donne lieu à cette action, et pour savoir que c'est une cause, nous devons savoir qu'elle est la cause d'une action, c'est-à-dire nous ne pouvons penser ni à la cause ni à l'effet séparément, c'est-à-dire ils sont corrélatifs les uns aux autres. Par conséquent, pour concevoir la cause, il faut d’abord connaître l’effet, et pour connaître l’effet, il faut d’abord connaître la cause. De cette preuve mutuelle il résulte que nous ne pouvons connaître ni la cause ni l'effet.
Quelques mots sur la façon dont le scepticisme ancien a interagi avec le christianisme émergent. Pouvons-nous dire que le scepticisme a entravé ou favorisé la propagation du christianisme ? La plupart des historiens de la philosophie croient que le scepticisme antique a préparé le terrain pour que la graine du christianisme tombe sur un sol favorable grâce à la prédication des apôtres. Opinions sceptiques dans les premières années après Jésus-Christ. étaient si répandus parmi les penseurs anciens que toute affirmation pouvait être perçue comme totalement fiable et digne. Et le scepticisme a préparé le monde antique à dire : « Je crois, parce que c’est absurde. » On peut donc dire que le scepticisme a joué un rôle préparatoire à la propagation du christianisme en Europe.
Le scepticisme a été développé dans les travaux de Lactance, qui considérait le scepticisme comme une bonne introduction au christianisme. Après tout, le scepticisme montre la futilité et la faiblesse de notre raison, il prouve que la raison ne peut pas connaître la vérité par elle-même, cela nécessite une révélation. Par contre, béni. Augustin montre une autre manière pour un chrétien de se comporter face au scepticisme : la manière de le surmonter. Dans ses travaux, il prouve que le scepticisme n'est pas une véritable philosophie. Selon Augustin, le scepticisme détruit la foi en la vérité, et puisque Dieu est la vérité, le scepticisme conduit à l’athéisme. C’est pourquoi tout chrétien doit mener une lutte implacable contre le scepticisme.