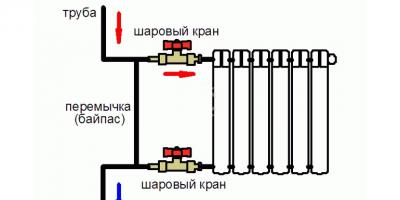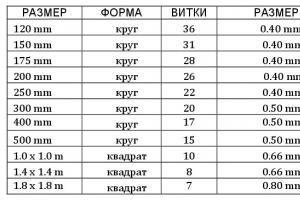Conférence n°5.
7.1. Caractéristiques d'éclairage de base.
7.2. Classification de l'éclairage industriel.
7.3. Exigences de base pour l'éclairage industriel.
7.4. Standardisation de l'éclairage industriel.
7.5. Sources lumineuses et dispositifs d'éclairage.
L'éclairage est l'un des facteurs de production les plus importants. Un éclairage industriel correctement conçu et exécuté de manière rationnelle a un effet psychophysiologique positif sur les travailleurs, améliore l'efficacité et la sécurité, réduit la fatigue et les blessures et maintient des performances élevées. Par conséquent, l'éclairage des locaux industriels est défini conformément à certaines normes et règles.
7.1. Caractéristiques d'éclairage de base.
La lumière visible est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde de 0,38 à 0,76 microns. La sensibilité de la vision est maximale au rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde de 0,555 microns (couleur jaune-vert) et diminue vers les limites du spectre visible. Le rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde de 0,01 à 0,38 microns correspond au rayonnement ultraviolet, de 0,77 à 340 microns - au rayonnement infrarouge.
Les porteurs du rayonnement électromagnétique sont les photons.
L'éclairage est caractérisé par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Indicateurs quantitatifs d'éclairage.
Flux lumineuxF– le rayonnement électromagnétique perçu par l'homme comme de la lumière ; mesuré en lumens (lm);
Toutes les sources lumineuses émettent un flux lumineux dans l'espace de manière inégale, c'est pourquoi le concept d'intensité lumineuse a été introduit.
Le pouvoir de la lumièreJ. – densité de flux lumineux spatial ; est défini comme le rapport du flux lumineux dF à l'angle solide dΩ , dans lequel il est distribué: J. = dF / dΩ; mesuré en candelas (cd);
Éclairage E– caractérise la densité surfacique du flux lumineux ; incident sur la surface éclairée : E=dF / DS, mesuré en lux (lx = lm/m2) ;
LuminositéL - caractérise la densité surfacique du flux lumineux émis par la surface dans la direction α (surfaces inclinées α à la normale est le rapport de l'intensité lumineuse DJ α , surface rayonnée, éclairée ou lumineuse dans cette direction, vers la zone DS projection de cette surface sur un plan perpendiculaire à cette direction) : L = DJ α / (DS cosα) , mesuré en cd/m2.
Lune – E comme satellite et L comme lanterne.
Les surfaces dont la luminosité en lumière réfléchie ou transmise est la même dans toutes les directions sont appelées la diffusion.
Indicateurs de qualité de l'éclairage.
Pour évaluer qualitativement les conditions du travail visuel, des indicateurs tels que l'arrière-plan, le contraste de l'objet avec l'arrière-plan, le coefficient d'éclairage de pulsation, l'indice d'éclairage et la composition spectrale de la lumière sont utilisés.
Coefficient de réflexion ρ- défini comme le rapport du flux lumineux réfléchi par la surface F négatif au flux lumineux incident sur lui F tampon : ρ = F négatif / F tampon.
Arrière-plan– C'est la surface sur laquelle se distingue l'objet. Le fond est caractérisé par le coefficient de réflexion ρ. Lorsque ρ > 0,4, le bruit de fond est pris en compte lumière;à ρ = 0,2...0,4 – moyenne et à ρ< 0,2 – sombre.
Contraste du sujet avec l'arrière-plan k – caractérisé par le rapport entre la luminosité de l'objet considéré (point, ligne, signe, tache, fissure, marque, etc.) et le fond :
k = (L F – L À PROPOS .) / L F, est considéré comme grand si k > 0,5 (l'objet se détache nettement sur l'arrière-plan), moyen lorsque k = 0,2...0,5 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent sensiblement en luminosité) et petit lorsque k< 0,2 (объект слабо заметен на фоне).
Si la luminosité du fond et de l’objet est égale, leur couleur peut différer.
Visibilité V caractérise la capacité de l’œil à percevoir un objet. Cela dépend de l'éclairage, de la taille de l'objet, de sa luminosité, du contraste de l'objet avec l'arrière-plan et de la durée d'exposition. V= k / k por , Où k depuis lors – seuil ou le plus petit visible à l'oeil contraste, avec une légère diminution dans laquelle l'objet devient indiscernable dans ce fond K POR = 0,01 – 0,015. La visibilité diminue fortement lorsque des sources lumineuses brillantes apparaissent dans le champ de vision - l'effet aveuglant -...
Indice de cécité P Ô – critère d'éblouissement action créée par l'installation d'éclairage,
R. Ô = 1000 (V 1 / V 2 – 1),
Où V 1 Et V 2 – visibilité de l'objet de discrimination, respectivement, lorsqu'il est protégé et en présence de sources lumineuses vives dans le champ de vision. Le blindage des sources lumineuses est réalisé à l'aide de boucliers, de visières, etc. Valeur maximum R. Ô pas d.b. plus de 40.
Coefficient de pulsation d'éclairagek E – c'est le critère profondeur des fluctuations d'éclairage dues aux changements du flux lumineux au fil du temps
k E = 100 (E maximum –E min )/ (2 E Épouser )
Où E maximum , E min , E Épouser – valeurs d'éclairage maximales, minimales et moyennes pour la période d'oscillation ; pour lampes à décharge k E = 25...65 %, pour lampes à incandescence conventionnelles k E = 7 %, pour lampes à incandescence halogènes k E = 1 %.
Les fluctuations de l'éclairage provoquent une fatigue visuelle, effet stroboscopique, causer des blessures. Méthodes de limitation d'ondulation: alternance uniforme de l'alimentation des lampes de différentes phases (réseaux triphasés), utilisation de luminophores à coefficient de séquelle élevé, alimentation des lampes avec des courants haute fréquence - 400 Hz, utilisation de lampes à 2 lampes alimentées selon un circuit à phases divisées.
Tension nominale de la source lumineuse- la tension pour laquelle une source lumineuse particulière est conçue, ainsi que pour laquelle elle peut être allumée avec un équipement spécial conçu à cet effet. Mesuré en volts (V, V).
Puissance nominale de la source lumineuse- la puissance consommée par la source lumineuse lorsqu'elle est connectée à la tension nominale, nécessaire pour convertir l'énergie électrique en lumière. Mesuré en watts (W, W).
Le flux lumineux est la puissance du rayonnement optique émis par une source lumineuse dans toutes les directions, évaluée par son effet sur l'œil humain. Le principal paramètre photométrique qui caractérise la capacité d'une source lumineuse à éclairer un objet particulier. La quantité de flux lumineux dépend de la longueur d'onde émise par la source lumineuse. Mesuré en lumens (Lm, Lm)
L'efficacité lumineuse est le rapport entre le flux lumineux émis par une source et la puissance qu'elle consomme. Sert de caractéristique de l’efficacité des sources lumineuses. Mesuré en lumens par watt (Lm/W, Lm/W).
Par exemple, l'efficacité lumineuse d'une lampe avec un flux lumineux de 11 600 Lm et une puissance de 110 W est de 11 600 : 110 = 105 Lm/W.
Soyez prudent lors de l'achat, faites attention au rendement lumineux de l'ensemble luminaire, et non à l'efficacité lumineuse des LED, car dans l'ensemble il y a une perte de flux lumineux due à l'efficacité du driver, ainsi qu'à la conception caractéristiques du luminaire.
La température de couleur caractérise la couleur de la source lumineuse. Mesuré en degrés Kelvin (K)
Plus la température de couleur est basse, plus la lumière est « chaude » ; plus la température de couleur est élevée, plus elle est « froide ». Par exemple, une lampe avec une température de couleur de 5 000 à 6 000 K émet une lumière blanche froide, 4 000 – 4 500 K – blanc neutre, 2 700 – 3 000 K – blanc chaud.
Sur l'image, vous pouvez voir quelles sources de lumière naturelle et artificielle correspondent à quelle température de couleur.
L'indice de rendu des couleurs (coefficient) caractérise le degré auquel la couleur naturelle d'un objet correspond à la couleur visible lorsqu'il est éclairé par une certaine source de lumière.
Désigné par CRI (indice de rendu des couleurs) ou Ra.

Facteur de puissance ou cosinus phi (cos) est appelé rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Puisque la puissance active est inférieure à la puissance apparente, le facteur de puissance est toujours inférieur à l’unité.
Le coefficient de pulsation est un critère permettant d'évaluer la profondeur des fluctuations de l'éclairage créé par une source lumineuse au fil du temps.
Lampes LED – jusqu'à 5 %
Lampes à incandescence, lampes halogènes – jusqu'à 5 %
Lampes fluorescentes – 5 – 45%
Lampes au mercure, au sodium – jusqu'à 80 %
Halogénure métallique – jusqu'à 100 %
L'éclairage est une grandeur physique égale au flux lumineux incident perpendiculairement par unité de surface éclairée. Mesuré en lux (lx, lux).
1 lux équivaut à un flux lumineux de 1 lumen tombant sur une surface de 1 m2.

Par exemple, l'éclairage de la terre par les rayons du soleil à midi est approximativement égal à 100 000 lux, et l'éclairage de la rue sous éclairage artificiel est approximativement égal à 4 lux.
Les paramètres d'éclairage standardisés pour divers objets sont réglementés par la loi.
|
Éclairage intérieur |
Éclairage requis, lux |
|---|---|
|
Pièces avec un niveau d'éclairage élevé : Bureaux, salles de travail, salles d'opération, caisses enregistreuses, bureaux d'études, d'études et de dessins, salles informatiques, laboratoires, auditoriums, espaces de vente d'épiceries, salons de coiffure, locaux techniques |
400-500 |
|
Pièces ayant des besoins d’éclairage moyens : Surfaces de vente d'autres magasins, salles de conférence et de réunion, salles de lecture, halls d'exposition, hôtels |
200-300 |
|
Salles de classe, salles d'étude, jardins d'enfants |
400 |
|
Pièces avec éclairage modéré : Halls et vestiaires de bâtiments industriels, halls et vestiaires de bâtiments publics, couloirs et passages de bâtiments publics, couloirs et passages de bâtiments résidentiels, escaliers de bâtiments industriels, toilettes |
75-150 |
|
Escaliers d'immeubles résidentiels |
|
|
Éclairage spécial intérieur |
Éclairage requis, lux |
|
Locaux de production, ateliers |
500 |
|
Entrepôts, installations sportives |
200 |
|
Automobiles, gares ferroviaires, aéroports, installations agricoles |
300 |
|
Passages pour piétons, tunnels |
100 |
|
Locaux techniques et de service |
100 |
|
Pièces avec des niveaux élevés de poussière et d'humidité |
200 |
|
Lumière d'extérieure |
Éclairage requis, lux |
|
Le territoire d'une entreprise industrielle, un complexe d'entrepôts, le territoire d'une station-service |
|
|
Parkings, coopératives de garages, parc, place, boulevard, quartier, zones automobiles, gares, aéroports |
La conception des systèmes d'éclairage selon des paramètres standardisés est réalisée par des spécialistes à l'aide de programmes spéciaux. Ci-dessous un exemple de projet d'éclairage d'une pièce de 6x6 mètres avec des downlights LED (lien vers Dvo18-30-01) d'une puissance de 30 W :
Vous pouvez en savoir plus sur les paramètres d'éclairage standardisés dans le Code des Règles

Conformément à GOST 17677-82, il existe plusieurs types de KSS. La possibilité d'utiliser un dispositif d'éclairage dans une zone particulière dépend du type de KSS.
|
Tapez KSS |
Zone de directions d'intensité lumineuse maximale (dans l'hémisphère supérieur et/ou inférieur) |
|
|---|---|---|
|
Désignation |
Nom |
|
|
Concentré |
||
|
Profond |
0°-30° ; 180°-150° |
|
|
Cosinus |
0°-35° ; 180°-145° |
|
|
Semi-large |
35°-55° ; 145°-125° |
|
|
55°-85° ; 125°-95° |
||
|
Uniforme |
||
|
Sinus |
70°-90° ; 110°-90° |
|
Plus l'angle de distribution du flux lumineux est étroit, plus le diamètre est petit, plus la directivité et le contraste du point lumineux sont élevés. Plus l'angle de distribution du flux lumineux est large, plus le diamètre du point lumineux est grand et plus l'éclairage est uniforme. Considérons le KSS type D d'une lampe de bureau standard
À partir du graphique, on peut déterminer que cette lampe émet une intensité lumineuse d'environ 425 cd dans la direction verticale vers le bas et qu'à un angle de 30°, l'intensité lumineuse est d'environ 325 cd.
Flux lumineux F – la puissance de l'énergie rayonnante, estimée par la sensation visuelle qu'elle produit, lumen (lm).
Intensité Lumineuse I– densité de flux lumineux spatial :
je = d F/ dω,
Où d F – flux lumineux (lm), uniformément réparti dans un angle solide élémentaire dω, moyenne (stéradian). L'unité de mesure de l'intensité lumineuse est la candela (cd), égale au flux lumineux
En 1 ml, s'étendant à l'intérieur d'un angle solide de 1 sr.
Éclairage– densité de flux lumineux surfacique, lux (lx):
E = ré F/ DS,
Où DS– surface, m2, sur laquelle tombe le flux lumineux d F.
Luminosité B– densité surfacique d'intensité lumineuse dans une direction donnée. La luminosité, qui est une caractéristique des corps lumineux, est égale au rapport de l'intensité de la lumière dans une direction donnée à l'aire de projection de la surface lumineuse sur un plan perpendiculaire à cette direction :
B=Je/ dS cosα,
Où je– l'intensité lumineuse dans une direction donnée, cd ; DS– surface rayonnante, m2 ; α – angle entre la direction du rayonnement et le plan, en degrés. L'unité de luminosité est cd/m2.
Qu'est-ce qu'une lampe ?
Quelles fonctions le luminaire remplit-il dans un luminaire ?
Quels sont les types de conception d’éclairage artificiel ? Pourquoi est-il interdit d’utiliser uniquement l’éclairage local ?
L'utilisation de l'éclairage local seul dans les locaux industriels est interdite, car le contraste marqué entre les zones bien éclairées et non éclairées entraîne une fatigue visuelle, ralentit la vitesse de travail et peut provoquer des accidents.
Qu'est-ce que l'éclairage général ? De quelles manières pouvez-vous augmenter l’éclairage créé par l’éclairage général ?
Qu’est-ce que l’éclairage combiné ? Dans quels cas est-il utilisé ?
Quels sont les avantages des lampes à incandescence par rapport aux lampes à décharge ?
Le principal avantage des lampes à décharge par rapport aux lampes à incandescence est leur rendement lumineux élevé de 40 à 110 lm/W. Ils ont une durée de vie nettement plus longue - plus de 10 000 heures, une faible température de surface de la lampe et un spectre d'émission proche de celui de la lumière du soleil, garantissant un rendu des couleurs de haute qualité. De plus, les lampes fluorescentes à décharge fournissent un éclairage plus uniforme et sont recommandées pour une utilisation dans les appareils d'éclairage général.
Quel est le principe de fonctionnement des lampes utilisées dans les salles de classe ? Quels sont les avantages de ces lampes ?
Repentir avec une décharge électrique de gaz dans la lumière visible.
Les lampes fluorescentes, en fonction du phosphore utilisé, créent une composition spectrale de lumière différente et sont disponibles en blanc (WL), blanc chaud (WLT) et blanc froid (CLW), lumière du jour (LD), lumière du jour avec rendu des couleurs corrigé. (CDC).
Quels sont les inconvénients des lampes à décharge ?
Les inconvénients des lampes à décharge comprennent également : la nécessité d'utiliser des dispositifs d'allumage spéciaux, la dépendance des performances de la lampe à la température ambiante et à la tension d'alimentation, la longue période de combustion des lampes à haute pression (10 à 15 minutes) .
Qu’est-ce que le facteur d’ondulation de la lumière ?
À P. = 100 (E Max. –E minutes) / 2 ·E Mer, où E Max, E min et E cf – valeur maximale, minimale et moyenne de l'éclairement pendant la période de sa fluctuation, lux.
La valeur du coefficient de pulsation d'éclairage varie de quelques pour cent (pour les lampes à incandescence) à plusieurs dizaines de pour cent (pour les lampes à décharge).
Quelle est la raison de la pulsation du flux lumineux des sources lumineuses ? Quel type de lampe a un coefficient de pulsation lumineuse plus élevé ?
Le flux lumineux de la lampe F au moment du passage de la valeur instantanée de la tension alternative du réseau par 0 diminue.
Riz. Le flux lumineux ondule avec une tension d'alimentation monophasée
Les lampes à décharge (y compris les lampes fluorescentes) ont une faible inertie et modifient leur flux lumineux Ф presque proportionnellement à l'amplitude de la tension d'alimentation. La grande inertie thermique du filament des lampes à incandescence empêche une diminution notable du flux lumineux de la lampe.
Comment puis-je réduire le facteur d’ondulation de la lumière ?
Qu'est-ce que l'effet stroboscopique et pourquoi est-il dangereux ?
Les valeurs acceptables de quels indicateurs d'éclairage artificiel sont établies par le SNiP 23/05/95 ?
En fonction de quels facteurs les valeurs admissibles des indicateurs d'éclairage artificiel sont-elles établies ?
Quels facteurs déterminent les caractéristiques de la performance visuelle ?
Objet de distinction
Arrière-plan– une surface adjacente directement à l'objet de discrimination, sur laquelle l'objet est observé. Le fond est caractérisé par un coefficient de réflexion qui dépend de la couleur et de la texture de la surface. Le coefficient de réflectance ρ est défini comme le rapport du flux lumineux Ф neg réfléchi par la surface au flux lumineux F incident sur celle-ci. Le fond est considéré comme clair lorsque le facteur de réflexion de la surface sur laquelle l'objet est observé est supérieur à 0,4 ; moyenne – avec un coefficient de réflexion de 0,2 à 0,4 ; sombre - avec un coefficient de réflexion inférieur à 0,2.
Contraste de l'objet de discrimination avec le fond K est déterminé par le rapport de la valeur absolue de la différence de luminosité de l'objet de discrimination DANS o et arrière-plan DANS f à la plus grande de ces deux luminosités. Le contraste est considéré comme élevé aux valeurs À plus de 0,5 ; moyenne – avec des valeurs À de 0,2 à 0,5 ; petit – aux valeurs À inférieur à 0,2.
Quel est l’objet de la discrimination ? Donne des exemples.
Par quelle caractéristique, obtenue lors du calcul de l'éclairage, la source lumineuse est-elle sélectionnée ? Quels paramètres de la lampe doivent être déterminés ?
Le flux lumineux requis de la lampe Ф est calculé, fournissant la valeur normalisée de l'éclairage dans la pièce E, et selon le référentiel d'éclairage, le type et la puissance d'un lampadaire avec un flux lumineux F GOST, proche en valeur de la valeur calculée, sont sélectionnés.
Éducation et recherche
Travaux de laboratoire
Etude de l'efficacité et de la qualité de l'éclairage
8.1. But et objectifs du travail
Le but du travail est d'étudier les caractéristiques quantitatives et qualitatives de l'éclairage artificiel, ainsi que d'évaluer l'influence de la source lumineuse et de la décoration colorée de l'intérieur de la pièce sur l'éclairement et le taux d'utilisation de l'installation d'éclairage ( η ).
Principaux objectifs de l'étude :
· Mesure de l'éclairage créé par diverses sources lumineuses et comparaison avec des valeurs standardisées ;
· Détermination du facteur d'utilisation de l'installation d'éclairage ( η );
· Mesure et comparaison des coefficients de pulsation d'éclairage créés par diverses sources lumineuses ;
· Évaluation de la dépendance du coefficient de pulsation lumineuse sur la méthode de connexion des lampes aux phases d'un réseau triphasé ;
· Observation de l'effet stroboscopique.
Partie théorique
informations générales
Éclairage– la réception, la distribution et l'utilisation de l'énergie lumineuse pour offrir des conditions favorables à la vision des objets et des objets.
L'éclairage doit être hygiéniquement rationnel, c'est-à-dire fournir:
Éclairage suffisant des surfaces de travail ;
Cohérence d’un éclairage uniforme dans le temps ;
Répartition uniforme de la luminosité dans l’espace environnant ;
Aucun éblouissement.
L'éclairage est d'une grande importance pour la santé et l'organisation du travail. Sous l'influence du rayonnement lumineux, les processus d'activité nerveuse supérieure sont accélérés, l'activité générale et l'activité des organes respiratoires augmentent. Le manque de lumière irrite les yeux, rend difficile la distinction des objets et ralentit le rythme de travail.
Le passage d'une luminosité du champ visuel à une autre nécessite un certain temps pour ce qu'on appelle l'adaptation de la vision, qui peut aller de 1,5 à 2 minutes lors du passage d'une pièce sombre à une pièce bien éclairée, et jusqu'à 5 à 6 minutes lorsque recul, au cours duquel la personne distingue mal les objets environnants, ce qui peut provoquer un accident. Un éclairage insuffisant lors d'un travail visuel intense ou une réadaptation fréquente de la vision entraîne une fatigue rapide, des maux de tête et une détérioration de la vision.
Il a été constaté qu'un mauvais éclairage est une cause directe d'environ 5 % et une cause indirecte de 20 % des accidents. L'augmentation de l'éclairage de la surface de travail améliore la visibilité des objets en augmentant leur luminosité et augmente la vitesse de distinction des pièces, ce qui entraîne une productivité accrue.
Ainsi, lors de l'exécution d'une opération d'assemblage de précision, l'augmentation de l'éclairage de 150 à 1 000 lux permet d'augmenter la productivité du travail jusqu'à 25 % et, même lors de l'exécution de travaux de faible précision ne nécessitant pas beaucoup de fatigue visuelle, d'augmenter l'éclairage du lieu de travail. augmente la productivité du travail de 2 à 3% . Un bon éclairage élimine la fatigue oculaire, facilite la distinction des produits en cours de transformation et accélère le rythme de travail.
Une diminution de l'éclairage entraîne une diminution de la productivité du travail, non seulement manuelle, mais aussi mentale, nécessitant de la mémoire et une pensée logique. Par exemple, une diminution de l'éclairage jusqu'à 50 % de la valeur standard peut entraîner une fatigue visuelle et une diminution de la productivité du travail de 3 à 10 % avec une augmentation simultanée des défauts des produits.
Selon la source lumineuse, l'éclairage peut être de trois types : naturel, artificiel et combiné.
Un schéma fonctionnel des types d'éclairage en fonction de la source lumineuse et de l'objectif fonctionnel est présenté sur la Fig. 8.1.
Riz. 8.1. Classification des types d'éclairage
L'éclairage artificiel, en fonction de son objectif fonctionnel dans les entreprises industrielles, est divisé en travail, sécurité, urgence, évacuation et service.
Éclairage de travail assure les conditions nécessaires au fonctionnement normal de l’installation d’éclairage ; il est obligatoire dans toutes les pièces et espaces ouverts.
Éclairage de sécurité– type d'éclairage de travail, il est installé le long des limites protégées des territoires des entreprises industrielles, des chantiers de construction, ainsi que des territoires de certains bâtiments publics.
Éclairage de secours– l'éclairage de sécurité, fournit les conditions d'éclairage minimales nécessaires à la poursuite des travaux lors de l'extinction temporaire de l'éclairage de travail dans les locaux et les espaces ouverts dans les cas où le manque d'éclairage artificiel peut avoir des conséquences graves pour les personnes, les processus de production, perturber le fonctionnement normal de les centres vitaux de l'entreprise et les centres de services de masse des consommateurs.
Éclairage d'évacuation sert à l'évacuation en toute sécurité des personnes des locaux et des espaces ouverts en cas d'extinction d'urgence de l'éclairage de travail.
Éclairage de secours utilisé pendant les pauses lorsque l'éclairage de travail est éteint, par exemple lors du nettoyage des locaux et pour leur protection.
Les instructions dans lesquelles un éclairage de secours et d'évacuation est nécessaire sont contenues dans le SNiP et dans les normes industrielles pour l'éclairage artificiel. Selon SNiP, l'éclairage de secours doit créer un éclairage d'au moins 5 % de l'éclairage standard, mais pas moins de 2 lux à l'intérieur et 1 lux à l'extérieur. Un éclairage de plus de 30 lux dans les pièces et de plus de 5 lux à l'extérieur est autorisé s'il existe des justifications appropriées.
L'éclairage d'évacuation doit créer un éclairage d'au moins 0,5 lux à l'intérieur et 0,2 lux à l'extérieur. Pour l'éclairage de secours et d'évacuation, des lampes à incandescence (y compris des lampes à incandescence halogènes) et des lampes fluorescentes peuvent être utilisées, ces dernières uniquement dans des pièces avec une température de l'air d'au moins +5 °C lorsqu'elles sont alimentées par un courant alternatif et une tension d'au moins 90 % de la tension nominale. Les lampes des types DRL, DRI et DNAT ne peuvent être utilisées que comme accessoires supplémentaires pour les groupes d'éclairage de secours afin d'améliorer l'éclairage au-dessus de la norme pour l'éclairage de secours.
Les émissions naturelles s’inscrivent dans une gamme extrêmement large de longueurs d’onde (Figure 8.2). Dans ce cas, les vibrations électromagnétiques avec des longueurs d'onde de 10 à 340 000 nm sont généralement appelées région optique du rayonnement, et la plage de longueurs d'onde de 10 à 380 nm est classée comme rayonnement ultraviolet, de 380 à 770 nm - dans la région visible de le spectre, et de 770 à 340 000 - dans la région du rayonnement infrarouge.

Riz. 8.2. Spectre de rayonnement électromagnétique.
La partie visible du spectre est étirée.
L’œil humain est le plus sensible aux rayonnements d’une longueur d’onde de 540 à 550 nm (couleur jaune-vert).
En général, la partie visible du spectre est perçue par l’œil humain comme de la lumière blanche. Les sections étroites individuelles de cette partie du spectre diffèrent en longueur d'onde et provoquent des sensations correspondantes de différentes couleurs. L'intensité de ces sensations visuelles n'est pas la même, car La sensibilité des yeux aux rayonnements provenant de parties du spectre visible varie.
En lumière naturelle, la sensibilité la plus élevée correspond à un rayonnement d'une longueur d'onde de 555 nm (lumière jaune), et la nuit (ou au crépuscule), le maximum correspond à environ 500 nm (lumière vert-bleu).
La sensibilité relative de l'œil aux rayonnements provenant des parties extrêmes du spectre visible (violet et rouge) est bien moindre et dépend de l'heure de la journée (Fig. 8.3).

Riz. 8.3. Courbes de visibilité relative :
1 - la nuit ; 2 - l'après-midi.
Caractéristiques d'éclairage de l'éclairage
Pour l'évaluation hygiénique de l'éclairage, les caractéristiques d'éclairage suivantes sont utilisées :
Flux lumineux F - la puissance de l'énergie rayonnante, évaluée par la sensation visuelle qu'elle produit. L'unité de flux lumineux est le lumen (lm).
Intensité lumineuse I α - densité de flux lumineux spatial :
Où dF- flux lumineux (lm), uniformément réparti dans l'angle solide dω.
L'unité d'intensité lumineuse est la candela (cd), qui équivaut à un flux lumineux de 1 lm (lumen) se propageant dans un angle solide de 1 stéradian.
Éclairage - Densité de flux lumineux superficiel, lux (lx) :
Où DS – surface (m2) sur laquelle tombe le flux lumineux dF.
Luminosité B - densité surfacique d'intensité lumineuse dans une direction donnée. La luminosité, qui est une caractéristique des corps lumineux, est égale au rapport de l'intensité de la lumière dans n'importe quelle direction à la surface de projection de la surface lumineuse sur un plan perpendiculaire à cette direction.
Où Je α - intensité lumineuse, cd;
DS- surface rayonnante, m2 ;
φ - angle entre la direction du rayonnement et le plan, en degrés.
Objet de distinction- l'article en question, sa pièce individuelle ou son défaut qui doit être distingué au cours du processus de travail. Par exemple, lors de la lecture - l'épaisseur des lignes de lettres, lors de la prise de mesures - la taille de l'épaisseur de la ligne de graduation de l'échelle de l'instrument, etc.
Les indicateurs qualitatifs qui déterminent les conditions du travail visuel sont le fond, le contraste de l'objet de discrimination avec le fond, l'indicateur de cécité et l'indicateur d'inconfort.
Arrière-plan- une surface adjacente directement à l'objet de discrimination sur laquelle il est observé. Le fond se caractérise par une réflectance qui dépend de la couleur et de la texture de la surface. Le contexte est considéré :
lumière- avec un coefficient de réflexion de surface supérieur à 0,4 (papier blanc mat - 0,55...0,65, badigeon à la chaux - 0,8) ;
moyenne- avec un coefficient de réflexion superficielle de 0,2 à 0,4 (peinture jaune - 0,4, tôle galvanisée - 0,2) ;
sombre- avec un coefficient de réflexion superficielle inférieur à 0,2 (brique rouge - 0,08...0,1, acier non traité - 0,05... 0,1).
Coefficient de reflexion ( ρ ) - le rapport du flux lumineux réfléchi par la surface au flux incident sur celle-ci. Peut être exprimé sous forme de fractions ou de pourcentages.
Contraste de l'objet de discrimination avec l'arrière-plan ( À) - le rapport de la valeur absolue de la différence entre la luminosité de l'objet considéré (point, ligne, marque, signe, tache, fissure, etc., qu'il convient de distinguer lors des travaux) et du fond sur la luminosité du fond . Le contraste est pris en compte :
grand- avec des valeurs de rapport supérieures à 0,5 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent fortement en luminosité) ;
moyenne- avec des valeurs de rapport de 0,2 à 0,5 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent sensiblement en luminosité) ;
petit- à des valeurs de rapport inférieures à 0,2 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent peu en luminosité).
Le contraste peut être direct ou inversé. Le contraste direct est un objet sombre sur un fond clair, le contraste inverse est un objet clair sur un fond sombre.
Afin de pouvoir caractériser plus complètement les grandeurs techniques d'éclairage de base et leur perception par l'homme, un certain nombre de concepts techniques d'éclairage sont utilisés. Ceux-ci inclus:
Éclairage standardisé- la limite inférieure de l'éclairement requis, fixée par les tableaux réglementaires, en fonction de la nature du travail visuel réalisé et de l'orientation du plan de travail dans l'espace.
Sortie de la lumière ( CO) - le flux lumineux émis par la lampe pour 1 W d'énergie dépensée et caractérise le rendement de la lampe, autrement dit son rendement. Mesuré en lm/W. Théoriquement, 1 W d’électricité peut produire un flux lumineux de 683 lm.
Lampe- une source lumineuse (lampe à incandescence, lampe à décharge) avec des luminaires conçus pour sécuriser et protéger la source lumineuse des influences environnementales, fournir de l'électricité et répartir le flux lumineux émis par la source lumineuse dans l'espace
Coefficient de pulsation du flux lumineux ( À P) :
![]()
Où E maximum, E min – éclairage maximum et minimum, respectivement ;
E av – éclairage moyen
Facteur de sécurité– est adopté lors de la conception de l'éclairage naturel, artificiel et combiné, en tenant compte de la diminution de l'éclairement pendant le fonctionnement en raison de la contamination et du vieillissement des remplissages translucides dans les ouvertures lumineuses, les sources lumineuses (lampes) et les luminaires, ainsi que les propriétés réfléchissantes des surfaces de la pièce . Accepté selon SNiP 23/05/95.
Rapport de laboratoire n°3
Par discipline : La sécurité de la vie
(nom de la discipline académique selon le curriculum)
Thème : « Recherche des principaux indicateurs de la lumière naturelle »
Complété: étudiant gr. TPP-09/Mikhaïlov A.A./
(signature) (nom complet)
Vérifié: assistant ____________ /Kovshov S.V./
(fonction) (signature) (nom complet)
Saint-Pétersbourg
Objectif du travail : Mesurer les principaux paramètres caractérisant l'éclairage naturel des locaux ; familiarisation avec la méthodologie de leur normalisation et de leur calcul.
Caractéristiques d'éclairage de base
Un éclairage des locaux industriels correctement conçu et exécuté de manière rationnelle a un effet psychophysiologique positif sur les travailleurs, contribue à accroître l'efficacité et la sécurité, réduit la fatigue et les blessures et maintient des performances élevées.
L'éclairage est caractérisé par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs comprennent :
flux lumineux Ф – partie du flux radiant perçu par l'homme comme lumière ; caractérise la puissance de l'énergie lumineuse, mesurée en lumens (lm) ;
intensité lumineuse J - une grandeur caractérisant la lueur d'une source dans une certaine direction et égale au rapport du flux lumineux dФ à un petit angle solide
dans lequel il est distribué: ![]() ; mesuré en candelas (cd);
; mesuré en candelas (cd);
l'éclairement E est le flux lumineux dФ par unité de surface éclairée dS (m 2) : ![]() ; mesuré en lux (lx);
; mesuré en lux (lx);
la luminosité L est une valeur caractérisant la lueur d'une source lumineuse dans une direction donnée. La luminosité d'un élément dS d'une surface lumineuse dans n'importe quelle direction est déterminée par le rapport de l'intensité lumineuse dJ de cet élément dans la direction considérée à l'aire dS de la projection de l'élément sur un plan perpendiculaire à la direction considérée : ![]() où est l'angle entre la normale à cet élément dS et la direction pour laquelle la luminosité est calculée ; mesuré en cd/m2.
où est l'angle entre la normale à cet élément dS et la direction pour laquelle la luminosité est calculée ; mesuré en cd/m2.
Pour évaluer qualitativement les conditions du travail visuel, des indicateurs tels que les caractéristiques de l'arrière-plan, le contraste objet-arrière-plan, le coefficient de pulsation d'éclairage, l'indice d'éblouissement et la composition spectrale de la lumière sont utilisés.
L'arrière-plan est la surface adjacente directement à l'objet de discrimination sur laquelle il est visualisé. Le contexte est considéré :
– la lumière dont le coefficient de réflexion superficielle est supérieur à 0,4 ;
– moyenne avec une réflectance superficielle de 0,2 à 0,4 ;
– sombre avec une réflectivité superficielle inférieure à 0,2.
Lors de la conception d'une installation d'éclairage, le facteur de réflexion des matériaux de construction et de parement doit être mesuré et pris conformément au SNiP 23-05-95 ou selon le tableau. Article 1 de la demande.
Le contraste de l'objet de discrimination avec le fond K est déterminé par le rapport de la valeur absolue de la différence entre la luminosité de l'objet et du fond sur la luminosité du fond. Contraste de l'objet de discrimination avec l'arrière-plan
compte :
– grand lorsque K est supérieur à 0,5 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent fortement en luminosité) ;
– moyenne à K de 0,2 à 0,5 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent sensiblement en luminosité) ;
– petit lorsque K est inférieur à 0,2 (l'objet et l'arrière-plan diffèrent peu en luminosité).
Le coefficient de pulsation d'éclairage Kp, %, est un critère pour évaluer la profondeur relative des fluctuations d'éclairage résultant des changements dans le temps du flux lumineux des lampes à décharge lorsqu'elles sont alimentées en courant alternatif, exprimé par la formule :
 (1)
(1)
où : E max et E min – respectivement la valeur d'éclairement maximale et minimale pour la période de sa fluctuation, lux ; E av – valeur d'éclairement moyenne pour la même période, lux.
L'indice d'éblouissement P est un critère d'évaluation de l'effet d'éblouissement d'une installation d'éclairage, déterminé par l'expression :
![]() (2)
(2)
où : S est le coefficient d'éblouissement, égal au rapport des différences de seuil de luminosité en présence et en absence de sources aveuglantes dans le champ de vision.
Analyseur visuel
L'analyseur visuel a la plus grande quantité d'adaptation. Lors de l'adaptation à l'obscurité, la sensibilité atteint un certain niveau optimal après 40 à 50 minutes ; l'adaptation à la lumière, c'est-à-dire la diminution de la sensibilité, dure 8 à 10 minutes. L'œil réagit directement à la luminance, qui est le rapport entre la quantité de lumière (intensité) émise par une surface donnée et la surface de cette surface. La luminosité est mesurée en lentes (nites ; NT); 1 nt=1 cd/m2. À des luminosités très élevées (plus de 30 000 nits), un effet aveuglant se produit. Une luminosité jusqu’à 5 000 nits est hygiéniquement acceptable.
Le contraste fait référence au degré de différence perçue entre deux luminances séparées dans l'espace ou dans le temps. La sensibilité au contraste permet de répondre à la question de savoir dans quelle mesure un objet doit différer en luminosité de l'arrière-plan pour être visible.
Lors de l'évaluation de la perception des caractéristiques spatiales, le concept principal est l'acuité visuelle, qui se caractérise par l'angle minimum sous lequel deux vue ponctuelle Nous sommes comme séparés. L'acuité visuelle dépend de l'éclairage, du contraste, de la forme de l'objet et d'autres facteurs. Avec l'augmentation de l'éclairage, l'acuité visuelle augmente. À mesure que le contraste diminue, l'acuité visuelle diminue. L'acuité visuelle dépend également de la localisation de la projection de l'image sur la rétine. L'analyseur optique comprend deux types de récepteurs : les cônes et les bâtonnets. Les premiers sont des dispositifs de vision chromatique, les seconds sont achromatiques. Lorsque l'énergie des ondes agissantes est égale, les différences dans leurs longueurs sont ressenties comme des différences dans la lumière des sources lumineuses ou dans les surfaces des objets qui la réfléchissent. L’œil distingue sept couleurs primaires et plus d’une centaine de leurs nuances. Les sensations de couleur sont provoquées par l'exposition à des ondes lumineuses d'une longueur d'onde de 380 à 780 nm. Approximativement, les limites des longueurs et les sensations (couleurs) correspondantes sont les suivantes : 380-455 nm (violet) ; 455-470 nm (bleu) ; 470-500 (bleu) ; 500-550 (vert) ; 540-590 (jaune) ;
590-610 (oranges); 610-780 (rouge). L'analyseur visuel a une certaine sensibilité spectrale, caractérisée par la visibilité relative du rayonnement monochromatique. La plus grande visibilité pendant la journée correspond au jaune et la nuit ou au crépuscule au vert-bleu. La gamme de transitions du blanc au noir forme une série achromatique.
La sensation provoquée par le signal lumineux persiste pendant un certain temps, malgré la disparition du signal ou une modification de ses caractéristiques. L'inertie de la vision, selon divers chercheurs, est comprise entre 0,1 et 0,3 s. Les sensations qui surviennent après la suppression du stimulus sont appelées images séquentielles. Avec un court signal lumineux, l’image émerge de l’obscurité plusieurs fois de suite. À faible luminosité, après 0,5 à 1,5 s, une image séquentielle négative apparaît (c'est-à-dire que les surfaces claires apparaissent sombres et vice versa). Avec un signal de couleur, l'image est colorée dans une couleur supplémentaire. Avec l'action soudaine d'un stimulus intermittent, une sensation de scintillement se produit, qui, à une certaine fréquence, se fond dans une lumière uniforme et non clignotante. La fréquence à laquelle les scintillements disparaissent est appelée fréquence critique de fusion des scintillements. Dans le cas où une lumière vacillante est utilisée comme signal, la question se pose du choix
fréquence optimale. La fréquence optimale est de 3 à 10 Hz. L'inertie de la vision provoque l'effet stroboscopique. Si le temps séparant les actes discrets d’observation est inférieur au temps d’extinction de l’image visuelle, alors l’observation est subjectivement ressentie comme continue. Avec l'effet stroboscopique, une illusion de mouvement lors de l'observation intermittente d'objets individuels ou une illusion d'immobilité (ralenti) qui se produit lorsqu'un objet en mouvement prend périodiquement sa position précédente est possible. Lors de la perception d'objets dans un espace bidimensionnel et tridimensionnel , une distinction est faite entre le champ de vision et la vision en profondeur. Le champ de vision des jumelles couvre dans la direction horizontale 120-160°, verticalement vers le haut - 55-60° et vers le bas - 65-72°. Lorsque la couleur est perçue, la La taille du champ visuel se rétrécit. La zone de visibilité optimale est limitée par le champ : vers le haut - 25°, vers le bas - 35°, vers la droite et vers la gauche de 32°. La vision en profondeur est associée à la perception de l'espace. L'erreur l'estimation de la distance absolue à une distance allant jusqu'à 30 m représente en moyenne 12 % de la distance totale.